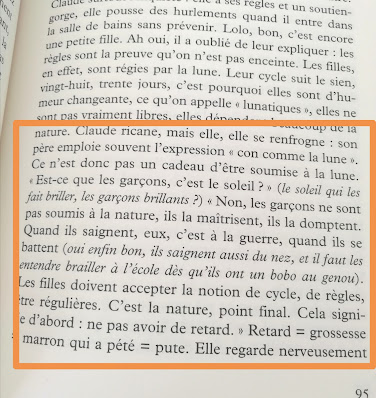Un bel et bouleversant hommage à un père parti trop tôt, un père aimant, amoureux fou de sa femme et de sa fille, une histoire de famille touchante, déchirante, une descente aux enfers et une émouvante histoire d'amour...Saturne c'est un peu tout ça à la fois. Des pages empreintes de vives douleurs et de mélancolie, d'une certaine tension et à la fois d'une intense lumière d'amour et d'espoir dans cette sombre nuit.
〰Sarah Chiche raconte la vie de son père, Harry, son enfance broyée par la médiocrité des adultes, la relation avec son frère - Armand, le préféré, celui qui réussit « Mais Armand n’aime pas Harry, ou plutôt, il l’aime comme on est forcé d’aimer les bons chiens qui trottinent à nos côtés, tremblants et frétillants, et lancent de biais des regards humides qui appellent la caresse. » -, la folle histoire d'amour avec celle qui deviendra la mère de l'auteure, Ève, la « plus déglinguée des enfants perdues ».
〰L'écrivaine raconte ses propres souffrances, son enfance bousillée par les pertes sèches « je vivais dans un monde où les objets apparaissaient tout aussi brusquement que les gens y disparaissaient, et où, du reste, comme les autres, on l’aura compris, je ne vivais pas vraiment », par les dissensions au sein de sa famille, ballottée, malmenée entre haine et amour. Elle raconte sa construction troublée, son parcours solitaire, écrasée, tout comme son père avant elle, par la violence des adultes, par le poids de son histoire.
Un parcours en lisière de vie, et dont l'issue semble ravageante. « La certitude que je ne pouvais pas me tuer puisque j’étais déjà morte s’est installée par degrés, en même temps que la sensation inexprimable d’être entièrement réfugiée dans une tête gigantesque contenant toutes les vies des vivants et des morts. »
C'est par l'écriture que l'écrivaine entamera le processus de (re)construction.
« Mais Saturne est peut-être aussi l'autre nom du lieu de l'écriture – le seul lieu où je puisse habiter. C'est seulement quand j'écris que rien ne fait obstacle à mes pas dans le silence de l'atone et que je peux tout à la fois perdre mon père, attendre, comme autrefois, qu'il revienne, et, enfin le rejoindre. Et je ne connais pas de joie plus forte. »
Convoquer les fantômes et (ré)apprendre à vivre avec. Un programme salutaire mené avec vigueur par Sarah Chiche.
« L’histoire de la famille de ma mère, je l’ai déjà racontée, ailleurs. Mais j’ai caché le cœur de ce qui m’a faite. Depuis l’enfance, je réponds à ce panneau muet, cette ardoise brandie par mon père sur son lit de mort, ce geste ultime d’écriture. Au départ, les mots manquent. C’est très lent. Sans cesse tout menace d’être détruit, broyé par les pensées qui m’assiègent et me condamnent à n’écrire que par bribes, à ne penser que par fragments. »
〰Elle raconte aussi le colonialisme, le racisme, « [Joseph] a haï Pétain mais se méfie du général de Gaulle. Il a parlé arabe avant de parler français, il se considère comme algérien, pense que les juifs et les musulmans sont frères et qu'au lieu de se battre comme des bêtes les uns contre les autres, le racisme qu'ils subissent de la part des colons comme de l'administration et de la police devrait les inciter à déposer les armes, et à dénoncer, ensemble, le rôle de marionnettes qu'on veut leur faire jouer. », l'exil « car ainsi voguons-nous disloqués dans la tempête des années, otages de la mer sombre où l'exil des uns n'efface jamais celui des autres, coupables et victimes du passé. », la cupidité, la vanité, le misérabilisme du monde.
Des instantanés autobiographiques de vie. Sarah Chiche nous fait entrer dans l'intimité de sa famille, une famille éclatée et c'est un peu comme si nous pénétrions à l'intérieur de leurs âmes, par petites touches intelligemment déposées au creux de ces pages.
C'est un récit bouleversant. La souffrance du deuil prend vie sous la plume de l'auteure, elle est exprimée avec tellement de sincérité, de mélancolie, de vérité que cela en est bouleversant. Pour Sarah Chiche, les « morts ne sont pas avalés, ni par l'eau ni même par la terre. Ils continuent de marcher parmi les vivants ».
« Ce qui tue, c’est aussi la condescendance et le mépris de ceux qui pensent que la douleur d’un deuil qui se prolonge relève d’une paresse de la volonté ou d’une faiblesse complaisante. »
« Nous vivons, en permanence, dans et avec nos morts, dans le sombre rayonnement de nos mondes engloutis ; et c'est cela qui nous rend heureux. »
Les dernières pages de Saturne m'ont émue aux larmes...
« Et sur la route où je pars, seule, mais avec mon père, seule, mais avec ceux que j'aime, seule, mais avec les mélancoliques, les amoureux, les endeuillés et les intranquilles, seule, mais cachée dans la foule des vivants et des morts, tout est perdu, tout va survivre, tout est perdu, tout est sauvé. Tout est perdu. Tout est splendide. »
Un livre dur. Sombre. Un livre beau. L' «histoire du crépuscule d'un monde, de la fosse incurable de nos regrets et d'une maladie mentale, la mienne, qui fut une damnation avant d'être une chance. »
« Son père s'approcha de lui, plongeant ses yeux dans les siens. Il lui chuchota quelques mots à l'oreille. Après deux reports provoqués par des révisions de dernière minute, la sonde Voyager 1 s'était envolée dans l'espace pour rejoindre sa jumelle, Voyager 2, partie quelques semaines plus tôt. Cette nouvelle le remplit de joie. A l'ambition, il avait toujours préféré les mystères des étoiles, le cinéma, les livres anciens. Et puis, Ève, sa femme. Il ne verrait jamais les images de Saturne ni des autres géantes gazeuses. Il se représenta peut-être toutes les années qu'il resterait à sa famille à flotter dans le vaste océan subglaciaire de leur bon droit à être ce qu'ils étaient, alors qu'il n'y a peut-être rien, aucun Dieu, aucun sens, qui puisse justifier que le bien consiste à ce conduire comme ceci ou comme cela, ni même qu'il y a un quelconque bien, ni même qu'il est pertinent de se battre pour continuer d'exister. »
« Ils avaient tous en eux l'espoir que ce ne serait qu'un mauvais rêve, mais en fait, tout cela, ce n'est pas un rêve, tout cela c'est pareil pour tout le monde, tout cela, ce n'est pas grand-chose, tout cela ce n'est que la vie, et, finalement, la mort. »
« L'histoire de ma mère, je l'ai déjà racontée, ailleurs. Mais j'ai caché le coeur de ce qui m'a faite. Depuis l'enfance, je réponds à ce panneau muet, cette ardoise brandie par mon père sur son lit de mort, ce geste ultime d'écriture. [« Ma femme, ma fille »] J'y réponds par l'écriture. Au départ, les mots manquent. C'est très lent. Sans cesse tout menace d'être détruit, broyé par les pensées qui m'assiègent et me condamnent à n'écrire que par bribes, à ne penser que par fragments. Tout gèle. Tout veut regagner l'immobilité glacée où je suis ce chien sans maître qui ronge le même os depuis toujours. »
« Dans les années 1960, les hôpitaux publics ne pouvaient plus accueillir tous les jeunes médecins désireux de se lancer dans une carrière hospitalière. Mais cela n'empêchait pas ces mêmes hôpitaux, quand le népotisme et l'arrogance des professeurs ne barraient pas la route aux juifs ou même aux protestants, peinaient à faire face au besoin toujours plus grand de lits, comme à se moderniser. On entassait dans des salles communes laides et sombres des malades par dizaines et de plus en plus de médecins, hospitaliers ou non, pour peu qu'ils aient l'esprit ouvert, s'étaient mis à lorgner du côté des cliniques privées et de leurs confortables salaires, plusieurs membres du gouvernement félicitant régulièrement les efforts admirables de l'hospitalisation privée. C'est à ce moment que Joseph joua tapis. »
« Il y avait quelque chose de pourri dans notre royaume. Je le sentais confusément. J'avais neuf ans. Et bien d'autres rêves ridiculement plus petits, solitaires et féroces, sans remède aucun. Les enfants savent tout mais ne comprennent rien. Leur égoïsme et leur silence les protègent - et, parfois, les rendent, malgré eux, monstrueux. »
« Le soleil d'août 1955 plane, indifférent à la haine et aux injustices centenaires. »
« [...] leur mère laisse flotter au vent, d'un geste vague et beau, un petit mouchoir brodé parfumé à la lavande, qu'aujourd'hui encore il m'arrive de humer même s'il n'exhale plus que son irrémédiable absence. »
« La nuit jetée sur le visage, il continue de lire, une lampe de poche à la main. Tout autour de lui, les autres forment enfin. Parfois, Harry voudrait qu'ils ne se réveillent jamais. Et qu'on le laisse pendant des jours, des semaines, des années, s'enfuir tout entier dans ces tunnels de mots et d'images qu'il a de plus en plus de mal à quitter. La voix de la vie y est joviale et rude, provocante, bigarrée, pleine d'éclats et d'étoiles. L'aube le rend à sa solitude. »
« C'était une douleur qui avait l'immensité du monde. Ce n'est plus rien. Pas même une question. Une histoire, scellée dans les nuits d'enfance, qui m'a percutée, et tuée, il y a des siècles. »
« Debout sur le pont avant, appuyée sur la rambarde, Louise fixe la Méditerranée vide de toutes ces épaves fantômes qui la hanteront cinquante ans plus tard - car ainsi voguons-nous disloqués dans la tempête des années, otages de la mer sombre où l'exil des uns n'efface jamais celui des autres, coupables et victimes du passé. »
« Elle ne dit plus rien. Alors, il embrasse ses yeux, il lui dit qu'elle est une infraction à la loi du jour, qu'il va boire ses larmes et qu'elle ne pleurera plus, qu'elle est belle, et pure, qu'elle fait sa joie, qu'il n'est pas permis d'être si heureux, qu'il va lui montrer ce qu'est la vie bonne, et qu'il se sent tous les courages, et qu'il va l'aimer, malgré toute cette nuit qu'elle a en elle, malgré la peur qu'elle lui inspire, parce que ça fait partie de l'amour. »
« Les Japonais nomment Takotsubo, qui veut dire « piège à poulpe », ce syndrome où, à la suite d'une rupture amoureuse, d'un deuil ou d'un choc émotionnel intense, le coeur se déforme, ses muscles s'affaiblissent et deviennent si paresseux que, tout à coup, littéralement, il se brise. La sidération de l'organe - ici, dans le syndrome de Takotsubo, la sidération du myocarde - se retrouve également, mais cette fois sur le plan de l'esprit, dans un cas de mélancolie extrême, de dépression anxieuse ravageante à son stade ultime. Dans ce trouble mental, connu sous le nom de délire des négations, la personne peut, à la suite d'un trop grand choc, avoir la conviction qu'elle n'a plus d'organes ou que certains d'entre eux sont pourris mais qu'elle ne peut pas mourir car elle n'est jamais née. J'ai vingt-six ans. Cela foudroie dans la prime jeunesse, à l'âge où la société attend de vous donner naissance. Autrement dit, à l'âge où vous devez vérifier pour tous que la vie est joyeuse et libre en étalant le spectacle de vos organes sains et vivants sous les yeux ravis de vos parents, de vos amis, et pour finir, du grand théâtre du monde dans lequel vous vous devez d'être l'entrepreneur optimiste, performant et conquérant de votre légende personnelle. »
« Toute naissance est la mort naissante d'un idéal : les enfants ne ressembleront jamais trait pour trait à la façon dont leurs parents et leurs grands-parents les ont rêvés. Toute éducation est un échec : les parents et les grands-parents blessent toujours, souvent même sans le vouloir, un enfant. Peut-être que dans notre famille les choses se passaient d'une façon plus grotesque que dans d'autres mais, si l'on prend la peine d'y réfléchir, il semble que, quel que soit le milieu, dans une famille la haine vise toujours, d'une manière ou d'une autre, l'extermination de ses membres les plus vulnérables. Je n'ai plus de peine pour ce qui nous est arrivé : incapable d'oublier, j'ai dû tout pardonner. J'ai de la peine pour cet art avec lequel les adultes mettent à mort leurs propres enfants. »
« Non, je ne veux plus penser à mes grands-parents paternels ni à mon oncle, que j'ai tant aimés et tant haïs, et j'ai tant déçue, à toutes les horreurs qui furent une insulte à la mort de mon père, et à toutes ces photographies, prises avant même sa mort, qui nous montrent heureux, pleins de tendresse et de douceur les uns pour les autres, mais où nous avons tous l'air de ces animaux aux yeux d'opale et de résine qu'on trouve chez le taxidermiste, dont on a retiré, tanné, et lustré la peau, pour en revêtir un squelette de bois imitant, à la perfection, la forme du sujet vivant. »
« On me disait que j'étais orpheline. On me disait qu'il me manquait quelque chose. Mais je ne savais quoi. On sait ce que l'on a perdu quand on se souvient l'avoir connu. On ne sait pas ce que l'on a perdu de ce qui a toujours déjà été perdu. Quand les adultes étaient occupés, ailleurs, j'allais, sans bruit, jusqu'au salon, regarder, posées sur une table à côté du piano, des photographies de mon père. Je passais devant les cadres. Je ne m'arrêtais jamais tout à fait. Je les regardais, de biais, en plissant les yeux. Dès que je m'attardais devant les photos, dès que je les regardais trop longtemps, j'étais prise au piège. Il n'avait l'air ni vivant ni mort. »
« J'étais le visage du pire. J'avais tout raté avec une obstination qui ne relevait pas de la distraction et ne tolérait donc aucun pardon. Je n'étais plus ni petite-fille, ni fille, ni épouse, ni amante. Je ne serais pas mère. Non. Plus rien avant, plus rien après. Parfaitement seule, entièrement libre. »
« L'idée qu'entre ceux qui nous ont précédés dans la succession des générations, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent et qu'une haine inexpugnable peut parfois cacher des sentiments exactement contraires me traversa soudain. »
« Tous les enfants rêvent à un moment donné qu'ils ont été adoptés - sauf les enfants adoptés. Je ne savais pas à quel moment mon père s'était dit que naître dans sa famille avait été une erreur. Que pour d'autres, cette famille aurait peut-être été une famille merveilleuse, car elle savait être drôle, et courageuse, elle avait aussi une forme de génie de la démesure, mais lui, ça allait le tuer. Je ne savais pas non plus pourquoi, pour leur échapper, mon père était tombé fou d'amour de la plus déglinguée des enfants perdues, de la plus atomique des bombes qui s'était fait tringler par des sales types et des types très sales. Sans doute avait-il vu en elle une forteresse sans porte ni fenêtre sous le plancher de laquelle il était persuadé que se trouvait le plus beau des trésors, son moi profond, qu'il exhumerait, pour la sauver, et la transformer, et qu'il l'avait donc délibérément couverte d'amour, de joie, de rires, de cadeaux et que finalement, d'après ce que l'on venait très aimablement de me signifier, c'était donc cela qui avait causé sa perte. Tout ce à quoi je m'étais désespérément raccrochée depuis toujours pour pardonner à ma mère sa folie et sa violence, tout ce que j'avais échafaudé, année après année, de toutes mes forces d'enfant, pour continuer à maintenir vivant en mon coeur l'amour qu'avaient eu mes parents l'un pour l'autre, venait de s'effondre d'un coup. C'était dégoûtant. Tout était dégoûtant. L'argent qui corrompt les coeurs. La cupidité des adultes, la mienne. Les mensonges de ma mère, qui depuis toutes ces années attendait donc peut-être patiemment que je meure à mon tour pour hériter de moi. Et mon père qui, comprenant sans doute tout cela, avait tiré sa révérence. Il avait eu raison. Tellement raison. J'allumai une cigarette. Je pris poliment congé de mon oncle et du notaire. Je redescendis la rue, mon enfance crevée dans mes poches vides. »
« Mes journées n'avaient plus de bord. La nuit ne tranchait plus, de son mordant, les jours de la semaine, un par un. Les heures m'appartenaient enfin. [...] Je me glissais dans la peau du silence, avec un bonheur que je n'avais jamais connu jusque-là - le bruit d'une goutte d'eau sur la bonde du lavabo, les ronflements de l'ascenseur ou les pas de ceux qui allaient et venait au-dessus devinrent, peu à peu, des événements à part entière.
« « Tout va très bien ». On jugera peut-être tout cela insensé. Pourtant, nos vies sont semées de ces moments où, affligés par un malheur que l'on ne peut souhaiter à personne, on arrive à le cacher à tout le monde : les enfants violés ou battus le savent mieux que quiconque.
Nos chagrins ne varient pas avec les siècles. Ils ne se mesurent ni à l'aune de nos mérites ni à celle de nos possessions. Un deuil reste un deuil. Un cadavre, un cadavre. Une tombe, une tombe. Mais si certaines personnes apprennent à vivre douloureusement avec la perte, d'autres se laissent mourir avec leurs morts. S'il est possible de faire comprendre aux personnes bien portantes ce qu'est une douleur physique [...] il leur est plus difficile de se représenter ce qu'est l'autoaccusation mélancolique consécutive à un deuil. Dès que vous sortez de l'inconscience du sommeil, ce que fut votre existence s'étale devant vous comme une flaque de goudron, poisseuse, puante. Tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous auriez dû faire. Tout ce que vous auriez pu dire à la personne disparue. [...] Tout se recouvre d'une glu noire qui comprime la poitrine, naphte qui brûle l'âme d'un feu lourd, dévaste vos boyaux, et fait défiler à toute heure du jour et de la nuit en arrière de vos yeux toutes les fautes que vous avez commises, ou pu commettre, ou sans nul doute commises sans le savoir, mais peu importe, car elles collent toutes les unes aux autres en un écoulement affreux. »
« On sait ce qu'est la dévalorisation. Plus perçante est la haine de soi. Elle méduse. On se regarde comme les autres vous regardent, comme un être qui aurait tout pour être libre et heureux, et qui rencontre cette haine féroce de soi, dans laquelle toutes vos pensées se réfugient pour vous faire mourir de l'intérieur. Mais ce qui tue, ça n'est pas seulement la douleur morale. Ce qui tue, c'est aussi la condescendance et le mépris de ceux qui pensent que la douleur d'un deuil qui se prolonge relève d'une paresse de la volonté ou d'une faiblesse complaisante. »
Quatrième de couverture
Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques, laissant derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d’Algérie. Se déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d’une grande lignée de médecins. Exilés d’Algérie au moment de l’indépendance, ils rebâtissent un empire médical en France. Mais les prémices du désastre se nichent au coeur même de la gloire. Harry croise la route d’une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d’un royaume où l’argent coule à flots. À l’autre bout de cette légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil, et dévoile comment, à l’image de son père, elle faillit être engloutie à son tour.
Roman du crépuscule d’un monde, de l’épreuve de nos deuils et d’une maladie qui fut une damnation avant d’être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d’amour : celle d’une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père.
Sarah Chiche est écrivain. Elle est notamment l’auteur du roman Les Enténébrés (Seuil, 2019, prix de la Closerie des Lilas). Elle est également psychologue clinicienne et psychanalyste.
Éditions Seuil, août 2020
205 pages
Prix du roman News 2020
Finaliste du roman Fnac 2020 et du prix littéraire du Monde
Sélection Prix Goncourt des Lycéens 2020