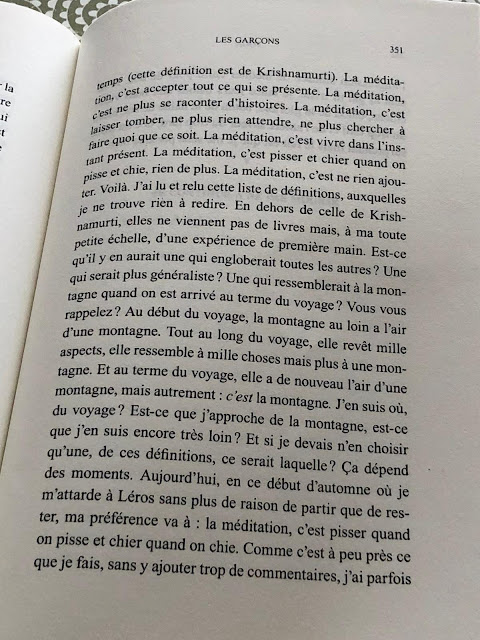C'est en voyage à Malaga, que je me suis imprégnée de cette histoire, non loin de quelques points de chute de Malek. Les pieds dans l'eau, sous le soleil éreintant, les mots de Walid Hajar Rachedi racontant les destins de Malek, un jeune français d'origine algérienne en quête de lui-même, de sa propre identité, d'Atiq, un afghan en quête de revanche, ou encore de Kathleen, une jeune anglaise, en quête de son père, m'ont touchée.
Une inégalité dans la narration ne m'a pas permis d'aller au coup de coeur. On s'y perd un peu parfois. Pourtant, ces périples, ces destins croisés me hantent encore, quelques jours après avoir refermé ce livre. Comme un appel à le rouvrir, à m'y replonger. La fin magistrale doit y être pour quelque chose.
Le destin tragique de l'Afghanistan inonde ces pages, et n'a pas été sans me rappeler l'analyse géopolitique de Barack Obama sur les conflits en Afghanistan dans "Une terre promise".
« Toutes les histoires ont déjà été racontées. Il n'y a que la voix de celui qui raconte qui change. »
Un roman d'apprentissage aux histoires qui s'entremêlent et qui interroge sur l'identité, l'exil, le métissage, la foi, les dérives de l'islam, l'engagement humanitaire, l'espoir de la jeunesse, l'amour.
Merci à lecteurs.com, aux éditions Emmanuelle Collas, à Walid Hajar Rachedi, à Geneviève Munier pour cet intense moment de lecture.
#prixorangedulivre2022
« Aussi, mais j’allais dire : toutes les histoires n’ont de valeur que pour ce qu’elles peuvent éveiller chez le prochain lecteur. C’est toujours la même histoire qu’on raconte, c’est toujours une nouvelle histoire qu’on entend. »
« - C'était qui ces gens ? Ces "Arabes" ? Al-Qaida ?
- Au début, on ne leur donnait pas ce nom-là. C'étaient seulement des combattants venus nous aider à mettre fin à l'occupation. Je me souviens que mon père ne les portait pas dans son coeur. Il se méfiait de leur influence. Il ne croyait pas à la vertu des gens qui ne connaissent pas la valeur d'une vie. Il disait ; "Les communistes disaient vouloir construire le paradis sur terre, eux promettent qu'ils sont les seuls à savoir comment l'obtenir dans l'au-delà. Tous des arrogants. On peut attirer les Afghans en enfer, mais pas les pousser au paradis..." »
« Juste un mur bordant la plage côté nord où s'écrasent les lumières des ferries. Juste un mur fermant la mer jusqu'aux confins de l'espace Schengen, au pied duquel apparaîtront bientôt ceux qui n'ont à perdre que leur vie. Et Atiq, si proche de l'Angleterre, si loin de son frère, se demande combien de temps encore il faudra s'enfoncer dans l'impasse du monde sans ciller. »
« Scotchant. Sur la légende du tableau, j'ai appris que Guernica n'était pas un nom inventé pour un conflit annoncé, mais seulement celui d'un village basque bombardé pendant la guerre civile espagnole par les nazis et les fascistes italiens à la demande de Franco. Et, tandis que le dictateur espagnol pilonnait son peuple, en France et en Angleterre on faisait comme si on n'avait rien vu - de bonnes habitudes qui ne dataient pas d'aujourd'hui.
Alors j'ai regardé ces visages apeurés, ces couleurs qui ont disparu, ces deuils qu'on n'arrive pas à faire, et j'ai repensé aux bombardements, à l'Afghanistan, à Atiq, à sa traversée en solitaire, à la vengeance que réclamait Wassim, son frère. Autre conflit, autres protagonistes, mais toujours le même résultat : une haine qui n'en finit pas.
Pour une toile, combien de Guernica, en vérité ? »
« Le visage de la danseuse de flamenco exprimait la même concentration, la même passion, la même intensité que des B-boys, si bien que je n'aurais pas été totalement surpris de la voir exécuter des figures au sol. Mais debout elle était, debout elle resterait, les volants de sa robe fendant l'air, le corps ensorcelé. J'étais subjugué par ce spectacle, par sa force, par sa beauté, par tout ce que cette transe convoquait d'émotions, de cultures, de mélanges. À Séville, le métissage n'était pas à chercher du côté des vieilles pierres, aussi belles soient-elles. Des hommes et des femmes avaient partagé quelque chose de plus profond, de plus important que des terres et des biens. Des hommes et des femmes s'étaient émus des mêmes choses, s'étaient reconnus dans les mêmes paysages, avaient transcendé leur peine par les mêmes danses, les mêmes chants. Avec leur flamenco, ces gitans, nomades parmi les nomades, en étaient à leur insu les flamboyants dépositaires.
Mon voyage commençait à trouver un sens. »
« Toutes les histoires ont déjà été racontées, il n'y a que la voix de celui qui raconte qui change. »
« J'ai moins peur de nos ennemis que de l'influence de nos mauvais amis. [...] Au siège de votre organisation, on doit considérer qu'après tout, la situation actuelle est un moindre mal. Quitte à faire quelques entorses à ses principes pour que l'ONG puisse continuer ses activités, il est plus simple de négocier avec les militaires américains qu'avec les talibans. [...] C'est sous l'influence de ces "mauvais amis" que nous, Afghans, n'avons eu pratiquement aucun mot à dire sur les décisions qui ont affecté notre pays, notre peuple depuis plus de vingt ans : avons-nous demandé aux Russes d'envahir notre pays ? Avons-nous demandé aux Américains de financer et d'armer les plus extrémistes des moudjahidines ? Avons-nous demandé aux services secrets pakistanais et saoudiens, à la CIA de soutenir l'émergence des talibans ? Avons-nous demandé que notre pays devienne le terrain d'entraînement des combattants d'Al-Qaida ? Monsieur Jeffrey, vous m'avez dit, une fois, que vous rêviez d'unité et d'un avenir meilleur pour l'Afghanistan et pour ses enfants. C'est un rêve que je partage du plus profond de mon âme. Mais comment notre pays peut-il être uni ou œuvrer à un avenir meilleur pour les générations futures s'il est le jouet de puissances pour lesquelles nos vies n'ont aucune valeur, dépossédé de son destin, ébranlé jusque dans son âme ? »
« J'ai demandé au chauffeur de monter le son, de ne pas nous tuer sur la route. Il roulait comme un dératé. J'ai fermé les yeux. J'aurais voulu mettre ce moment dans une boîte. Une boîte que je garderais précieusement pour les jours où j'oublierais qu'il existe d'autres vies que la mienne. »
« - Oui, c'est beau de s'abandonner à quelque chose qu'on n'est pas certain de comprendre, croire à ce qu'on ne peut pas voir... Ce que tu appelles la foi, j'appelle ça l'amour. Pour moi, il n'y a de paradis que dans les moments que nous passons avec ceux que nous aimons. »
« - Mais, Papa, t’entends ce que tu dis ! Donc tout ce qu’on nous raconte ne serait qu’un tissu de mensonges ? Big Brother, quoi ! à ce compte-là, on n’a plus qu’à jeter tous les livres d’histoire à la poubelle…
- Mais l’histoire, ma fille, c’est un récit. Un récit qu’un peuple se raconte à lui-même. Un récit qui a ses biais. Tu sais ce que disait Churchill sur l’histoire ?
- « L’histoire est écrite par les vainqueurs », c’est ça ?
- Et tu crois qu’il avait tort ? Qu’est-ce que tu vois par la fenêtre ?
- L’entrée de la gare de Waterloo ?
- Et Waterloo, c’est quoi pour nous, Waterloo ? C’est le nom de la bataille qui a défait Napoléon, qui a défait un tyran. « Napoléon le tyran », est-ce que tu crois que c’est ce qu’apprennent les petits Français à l’école ? Non, dans leurs livres, Napoléon, c’est un héros, le bâtisseur de l’Europe, le dernier empereur français, inhumé tel un pharaon aux Invalides… Et la gare qui porte son souvenir à Paris, comment s’appelle-t-elle ? Waterloo ? Non, bien sûr, c’est la gare d’Austerlitz ! Austerlitz, du nom d’une bataille victorieuse et décisive pour la France… Toute histoire a un autre versant. Le propre d’un empire, c’est de créer sa propre réalité. »
« Je n'ai jamais compris à quoi pourraient servir Thalès, Pythagore et leurs foutus théorèmes, mais j'entends le mot « contraposée » qui résonne dans ma tête. Un raisonnement par l'absurde qui dit que, si je ne fais pas partie de cet ensemble, c'est que je dois faire partie de l'autre.
Contraposé. Posé contre, vraiment tout contre.
Au milieu de cette place, à Oran, j'ai leur visage, un million de fois leur visage, mais je ne partage rien de leurs desseins, de leurs destins. Dans ma vie, j'ai eu des galères. Ceux qui ont mon âge ont connu la guerre civile. De celles qui ébranlent jusqu'à l'âme, tachent de noir votre enfance, confisquent votre adolescence. La paix reste une idée fragile, une réalité plus fragile encore. En témoignent ces barbelés qui éclipsent les petites merveilles d'architecture mauresque, ces regards inquisiteurs quand je m'exprime dans un arabe hésitant, ces malheurs qu'on veut me raconter. J'écoute, gêné. Je ne sais pas quoi dire. J'ai tout à coup envie de leur parler d'ailleurs. »
« C’est peut-être ça, l’amour : un abri. »
Quatrième de couverture
Quand Malek, 17 ans, rencontre Atiq, jeune Afghan en exil à la recherche de son frère qu'il veut empêcher de se faire justice contre les Américains, il cède à l'envie d'aller voir le monde de ses propres yeux. En route vers Tanger, il rencontre Kathleen, Londonienne dont il tombe amoureux et dont le père, humanitaire, a disparu à son retour d'Afghanistan. Paris, Kaboul, Grenade, Oran, Le Caire. C'est la même histoire que Malek se raconte et s'entend raconter, celle d'un ailleurs fantasmé qui n'existe plus ou qui n'a jamais existé.
Avec ce premier roman d'une grande maîtrise, Walid Hajar Rachedi nous embarque dans une quête terrible et solaire jusqu'à l'ultime dénouement à Londres, où convergent récits et destins.
« Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, où j'ai vu pêle-mêle des noms connus parmi les victimes et les bourreaux, j'ai fait le triste constat que nous n'étions finalement pas si nombreux à pouvoir convoquer une double conscience. »
Walid Hajar Rachedi
Éditions Stock, janvier 20222
296 pages