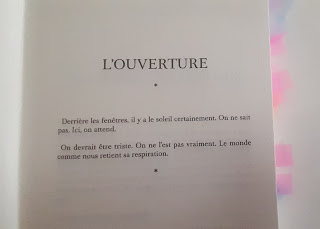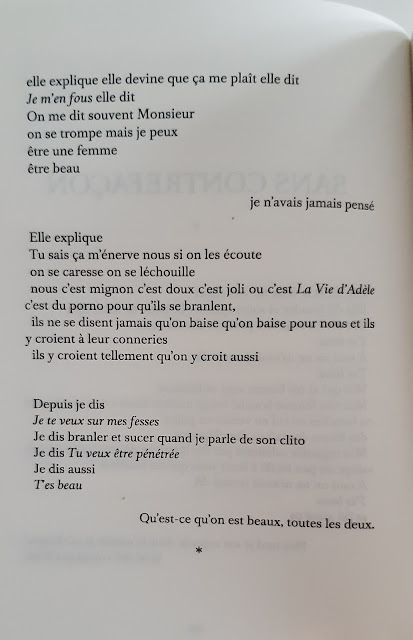Ouvrir "L'Éden à l'aube", c'est embarquer pour un beau voyage enchanté, très loin, dans une humanité hors du temps. C'est le ciel, ici, qui est le narrateur. Il nous conte et commente, mieux que personne ne pourrait le faire, l'amour fou entre Isaac et Gabriel dans une réalité complexe, balayée par un vent de sable d'une inouïe violence, le khamsin venu d'Égypte - violence que l'on comprend volontairement exagérée. En écoutant un interview de l'auteur sur France Culture, il explique justement que ce vent exagérément violent lui a permis de soustraire le territoire de la Palestine au réel.
Le ciel nous conte aussi le projet un peu fou de ces amoureux, de partir en vacances, dans leur propre pays et rejoindre une contrée pleine de magie.
Et ce choix des prénoms ❤️
Et ce narrateur, atypique quand même, vous en conviendrez, qui bouscule le lecteur, qui n'hésite pas à l'interpeller, guettant presque sa réaction. Un voyeur charmant, bienveillant mais aussi impuissant. Il sait la beauté et l'amour, il sait la violence aussi.
« Ils sont nés en ces terres empêchées par le béton et l'histoire et les tanks et le sang et la peur dans la nuit. Parfois, Isaac a l'impression d'être un rien dans son cœur. Parfois, Gabriel aussi.C'est comme ça. »
Les caresses infinies du ciel et du vent font écho à l'immensité des formes de langage, des sentiments qui imprègnent ces pages et des réflexions qui en ressortent.
J'ai aimé retrouver Jérusalem - dans laquelle j'ai eu plaisir à déambuler il y a quelques années -, à travers la plume de Karim Kattan : une ville labyrinthe, extraordinaire, figée dans le temps.
Une lecture empreinte de lyrisme, de poésie, une ode à l'amour, à la liberté, à la Palestine, à la lumière, à l'imaginaire.
Bravo et merci Mr Karim Kattan pour vos mots et ce texte bouleversant.
« Un enchanteur puissant,
A, jadis, en jardin, transformé la princesse.»
Jean Cocteau, Renaud et Armide
« L'ami ambigu qui sauta la fenêtre erre encore. Il n'a pas, en touchant le sol, abdiqué sa forme. Mais que je l'assiste seulement et le voici halliers, embruns, météores, livre sans bornes ouvert, grappe, navires, oasis... »
Colette, La Naissance du jour
« Gabriel, au même âge, voulait être jardinier. Il pensait qu'une main divine (une vraie main, Isaac, dira-t-il plus tard, genre énorme dans le ciel, la main du dieu) le soir venait colorier le ciel de ses couleurs de nuits et, le matin, avec sa gomme effacer la nuit. Si bien que pour lui, le jour n'était que la nuit effacée. Il trouvait cela incroyable, jour après jour, année après année, de toujours rater le moment où la main effectuait son travail. C'était invraisemblable. Il n'en parlait jamais à personne parce qu'il s'agissait d'une évidence, comme quand le vent souffle. Parfois la main s'amusait à des expériences, quand elle inondait le ciel de rouge d'orange et de rose, avant de revenir à nouveau peindre tout de noir et alors il se rendait compte que le ciel était un jardin de couleurs. Et Gabriel aimait beaucoup répéter les gestes de la main du dieu jardinier, remplir ses carnets de coloriage de noir, du très beau noir, noir du ciel, ce noir nocturne si particulier, unique à cette main. Car c'était ça le jardinage: dessiner plein de ciels, d'abord les ciels, toutes les couleurs du ciel puis, peu à peu, la terre, celle qui fait face au ciel, et ce qu'il y a sur la terre, les hommes, les bêtes, les routes, et l'espace merveilleux qui se trouve entre les choses. »
« Isaac allait à une école cosmopolite. On y fréquentait à la fois des gens comme lui, qu'on nommait poliment les locaux ; des gens comme eux, les autres, le peuple de soldats; et même des étrangers qui séjournaient ici pour des raisons qui lui étaient obscures (plus tard il comprendrait : vivre dans les endroits comme ici, pour ces gens nés dans des pays où rien ne les oblige à venir dans ces coins de merde, ça fait classe à raconter et ça paye un bon pactole de thunes.) En tout cas, sa mère était prévoyante. Elle voulait absolument qu'il parle sa langue, leur langue, et aussi la langue des autres. Elle voulait donner à Isaac toutes les chances qu'elle n'avait pas eues, c'est-à-dire lui donner accès à la planète. Clara et l'école, pour armer son âme à l'échappatoire si un jour cela s'impose. Pour impressionner les soldats et les oncles. »
« (Des années plus tard, Isaac adulte n'aurait plus beaucoup de souvenirs de son enfance. Mais il se souviendrait au millimètre près du visage gênant d'Ézéquiel, de ses yeux, du goût que ça fait dans la bouche de penser à Ézéquiel, de l'odeur qu'il sentait parfois, des fluctuations de sa voix, de l'épaisseur de ses cheveux lisses, de son visage blanc et pâle et délicat ; de sa manière de tenir sa kippa sur sa tête lorsqu'il courait pour attraper le ballon. Il garderait ce souvenir précis, celui-là, comme une preuve d'amour quand Ézéquiel rejoindra l'armée. Ce n'est pas grave, qu'il devienne soldat, meurtrier, sanguinaire, qu'il aille tuer, qu'il aille s'enivrer de mort, se bourrer la gueule de haine, je me souviens de lui, courant pour attraper la balle, et retenant sa kippa sur son crâne comme s'il craignait de perdre la tête ou de s'envoler, de se métamorphoser en oiseau, et de me quitter pour toujours; je me souviens de sa plus grande innocence.) »
« Trois mers, un lac, un fleuve. Vous voyez ? Isaac et Gabriel viennent d'une terre qu'on nomme parfois Palestine et qui, si l'on veut, est un isthme. Voilà, c'est inévitable, c'est ainsi : il faut bien accepter de le nommer. Il faut bien l'ancrer dans cette réalité-là, sans quoi il s'envolerait, il deviendrait air, rien, inconsistance mais de la pire des façons.
Ils viennent de. C'est-à-dire qu'ils émergent d'ici, portent le sceau d'ici, la malédiction qui les accompagne là où ils vont. Viennent de, c'est-à-dire qu'ici commence leur chemin qui se terminera, aussi, ici, et ils ne pourront jamais s'en échapper. Viennent de : chose banale, qui ne signifie rien d'autre qu'une vitesse de collision. La question est : contre quoi vont-ils s'écrabouiller, se défoncer ? C'est la question de chaque vie. »
« Ils sont nés en ces terres empêchées par le béton et l'histoire et les tanks et le sang et la peur dans la nuit. Parfois, Isaac a l'impression d'être un rien dans son cœur. Parfois, Gabriel aussi.
C'est comme ça. »
« Je vois, désormais, Isaac adolescent, ou juste avant. Il a, je dirais, dix ans. Il est sombre, mais pas taciturne, non, un peu l'inverse, il parle trop et souvent et vite. Il vit, avec sa mère à la magie sauvage, dans le village près de Jérusalem, ville des recoins et des angles morts. Après l'école, et avant de rentrer en bus chez lui à temps pour le dîner, il a quelques heures où il fait ce qu'il veut.
Et ce qu'il veut, c'est rester dans les ruelles de la vieille ville. Étrange locution que « vieille ville » pour dire la ville du dedans, par rapport à la nouvelle ville, celle du dehors. Pour dire la ville à nous, froncée, froissée, impossible, par rapport à l'autre, ouverte et dépliée, à eux.
C'est un monde constitué avec ses propres règles, ses paramètres, ses cartographies secrètes.
Il y a des quartiers et des régions, des clans, des empires, des alliés et des ennemis, des allégeances et des pactes, et des fiefs, et des covenants, et des trahisons et des perfidies, et des trésors cachés, des ruelles couleur d'or et des escaliers qui mènent au ciel. Il y a des recoins inconcevables, des commissures inconnues, replis, sinuosités, tréfonds. Il y a des gens de toutes les tailles et des fenêtres de toutes les formes et des lanternes de toutes les couleurs, jaunes et rouges et vertes et violettes. Parfois, il y a des arbres bleus ou roses, parfois des anges qui, en route pour une course céleste éminente, se sont arrêtés au pied d'un mur quelques instants pour roupiller ; parfois des chiens, qui sont des jinns, viennent vous parler et parfois ce sont les oiseaux, des jinniat, qui chantent en leur joli latin et parfois c'est seulement une sainte joufflue qui lévite parmi les citronniers. Il y a des touffes d'herbes qui poussent dans les fissures des murs et du sol. Il y a des piscines vides, antiques comme le temps, mais où le souvenir de l'eau persiste. Il y a des vieilles femmes plus vieilles que la terre, des jeunes belles aux lèvres rouges, il y a des moches aussi, beaucoup de moches, des femmes et des hommes moches et inoubliables, une verrue là, un œil en moins ici, lui qui claudique et l'autre qui ronfle en plein jour sur son tabouret. Il y a mille langues et mille races et mille planètes à la fois, il y a le monde entier encombré. Il y a des sultanes et des coiffes d'or, des robes brodées de noir, de cramoisi, de mauve, d'orange. Il y a des boutiques, tellement de boutiques, des étoffes, des peluches, des diamants, des chocolats, des jeux d'échecs, des t-shirts, des pistaches d'Alep, des noix Kabuki, des viandes, de l'or, des foulards multicolores, du polyester et de la soie et du coton, et du bois d'olivier et de la nacre, partout, de la nacre, de la nacre. Il y a des marchands de parfums et des joailliers, des fioles remplies de liquides colorés et fluo qui étincèlent dans la nuit des ruelles, des bocaux d'épices, et si on sait à qui demander, on peut même y acheter des crânes avec des joyaux dans les orbites, des poignards sertis de diamants. Il y a de l'or partout, Jérusalem d'or faux, de nacre vraie, et les parfumeurs et les joailliers et les vendeurs d'étoffes enturbannés et placides qui ressemblent à des sorciers assis au milieu de leurs marchandises. Et tant de murs éventrés en confettis et bibelots, bigarres et barioles, et tout cela est baigné d'ombre, de lumière; tout cela, opalin, jaspé. Tout labyrinthe.
Et il y a, parfois, quand on a tourné un coin de rue dans cette ville couverte, recouverte, mille fois voilée, il y a moi, le ciel, qui me découvre comme une surprise, moi le ciel bleu parfois, parfois amarante, toujours indéfinissable à part par ce mot-là, ciel, qui contient toutes mes multitudes de formes et de couleurs. J'ébahis parfois Isaac, ainsi. Et dans les allées, la lumière tombe de ce ciel sur le sol toujours d'une manière inouïe. Il n'y a, nulle part et jamais, la même tombée de lumière.
Sur cette étendue de moins d'un kilomètre carré le monde s'était replié sur lui-même en un origami si complexe, un labyrinthe si changeant, une négation si irrévocable des points cardinaux, qu'il était impossible de s'y retrouver, et impossible que la ville reste fixe. Car Jérusalem avait abdiqué toute géométrie. Et dans les ruelles et les parvis il y a toujours des vendeurs poussant leur charrette, qui proposent nounours ou maïs, pâtisseries ou café, ka'ak, œufs durs et zaatar. Et ceux qu'Isaac préférait, les jeunes mecs magnifiques, affublés d'improbables costumes, de beaux fez brodés d'or, comme des runes magiques sur leur front et qui servaient le thé comme on fait une acrobatie.
Isaac est là, je le vois, dans ce nombril du monde disloqué. La certitude, impensée, que le monde qui pourtant lui est si hostile, et lui a démontré mille fois qu'il lui était hostile, est bien à lui. Ici, dans cette Jérusalem de paume de main, ce minuscule qui n'en finit pas d'être minuscule, ce tout petit territoire exigu, où tout le monde connaît tout le monde, on respirait contre toute attente l'inconnu. Excitation des horizons, des possibles... Sans avoir jamais vu d'océan, et s'il avait été un enfant propice à l'analogie il aurait dit : parfois, Jérusalem est comme l'océan (alors que je dirais, plutôt, que Jérusalem est un ciel, exactement comme moi). Et dans certains coins, ces petites contrées de Jérusalem, il y a des jungles, des déserts, des banquises, des archipels.
Et puis il y avait les tunnels, qui mènent d'un marché à l'autre, d'un quartier à l'autre. Les tunnels qui font passer d'une zawiya à un joaillier, d'un marché de fragrances à une synagogue, d'un couvent à un marché d'épices, d'une mosquée à un boucher. Entrer dans l'obscurité en plein jour. Les tunnels, c'est là qu'il apprit la beauté des garçons. C'est qu'ils sont beaux, les garçons, et leur beauté fait très mal parfois. »
« Gabriel n'avait aucune envie que sa vie change. Il ressentait juste, parfois, un sentiment bienvenu, comme un chagrin doux et léger. Il infusa dans ses carnets des réminiscences involontaires de cette après-midi chez la vieille Fátima, dont la maison prit place au côté de Jérusalem comme si elles étaient l'une aussi vaste que l'autre. Les cartes d'un univers se rétrécissaient pour accommoder l'étendue d'un sentiment, continental, qui naquit en lui dans la pénombre du salon. »
« Moi qui suis plus profond que le bleu et vieux comme le monde, je me souviens d'autres comme eux. Moi qui ai écouté les mots d'amour dits par Salomon à sa Reine du Midi, par Balqis à son Roi, par Balqis encore qui montra ses jambes velues au roi et - je vous dis la vérité - vit le roi devenir fou de désir parce qu'il contempla ses jambes poilues. Moi aussi j'ai vu, oui, Salomon par terre, à quatre pattes sur le sol étincelant, léchant les jambes de Balqis qui soulevait sa robe pour découvrir l'étendue de ses forêts. La reine poilue des énigmes, envoûtante sorcière du matin, et le roi magicien, à la délectable barbe. Des poils enroulés dans d'autres poils mille fois. Je vous dis qu'il serait allé jusqu'à Ophir s'il le fallait, aurait quitté Jérusalem et son domaine et ses sujets et sa descendance, pour avoir à nouveau l'opportunité de lécher les jambes de Balqis et lécher, sur le sol, les reflets de Balqis. Moi qui ai vu ça, moi, témoin des mots d'amour, qui surplombe la sainte Jérusalem, la riche Saba, et le Waqwaq lascif.
J'ai vu tout le peuple de Jérusalem ahuri devant le roi et la reine ; peuple qui emporte dans ses prunelles l'image de la salive de leur roi sur les jambes de la reine à la lueur des flambeaux de résine ; de Salomon prostré dans sa sublime parure de noir tissée de pourpre, son ceinturon d'or qui pend comme une queue dorée, laissant apercevoir quelque chose de son entrejambe royal, ses pieds nus plaqués contre le sol froid, et sa barbe tressée et nattée d'or qui s'emmêle aux poils nombreux et denses de la reine comme la lumière des étoiles un soir sans lune dans les forêts.
La reine des énigmes possédait un pilier, aussi haut que moi, sur lequel était inscrit le savoir des humains, des animaux, des anges, et des jinns. Il suffisait de savoir le lire, et de savoir grimper, pour avoir accès à ce que l'on désire. Elle l'offrit à son roi, lui donna, généreuse comme elle était, la Reine du Midi, le savoir du monde. Et quand elle lui posa l'énigme, quand elle lui demanda le chiffre et la lettre, vous savez quoi, le beau roi Salomon, le sage roi Salomon, Salomon des jinns et des jugements, il donna sa langue au chat. Tout ce qu'il savait faire, c'était ne rien savoir, lécher la reine et ce que touchait la reine.
Moi, donc, le ciel qui sais les arcanes de l'amour. »
« Un aparté. Soyez patients, car comme vous aimez le rappeler à vos enfants, la patience est une vertu. Et puis ce n'est pas facile pour moi de tout énoncer, et de devoir vous le rappeler, ici et là, car vous oubliez. Oui, je sais que vous oubliez les détails, alors que je les ai choisis et formulés avec précaution, que je les dispose avec un soin infini. Que je constitue leur récit au mieux pour qu'ils y vivent et s'y épanouissent. Mes deux bébés, mes deux amoureux.
Je ne veux pas revenir trop souvent sur cet aspect-là - loin, loin, loin de vos oreilles le mal - mais vous constaterez qu'ils viennent d'un peuple occupé dans un pays occupé. Ils ne le mention-nent pas, car on ne parle pas jour et nuit de ce qui constitue l'étoffe de nos existences. Sachez que c'est la chose qui est toujours là, partout. Dans leur ciel et sous terre et dans les regards et dans chaque geste, c'est l'occupation qui régit l'existence, qui l'organise, la permet, la soustrait. Toute leur vie dépend de ça. Pourquoi pensez-vous que Gabriel dessine tant ? Sans cet élément, cette histoire ne veut rien dire. Rien du tout. Du bruit, du bruit, du bruit.
Moi, je voulais seulement vous conter leur amour et le commenter. Mais en réalité comment vous décrire leur amour sans vous dire la minutieuse administration dans lequel il est né ? Qu'est-ce que tout cela signifie si vous ne savez pas quels sont les papiers, les frontières, les finances, qui organisent la vie de l'un et de l'autre ? Rien, rien que des mots. Car voilà, l'un comme l'autre vit dans un pays qui n'est pas vraiment le leur. Ils vivent enchaînés à des systèmes conçus pour les empêcher, élaborés pour maintenir leur vie au stade minimal, pour couper l'épanouissement et, ainsi, tuer dans l'œuf la possibilité de vivre libre ou amoureux. C'est-à-dire qu'ils vivent, colonisés, dans un espace dont les coordonnées sont composées de telle manière à empêcher qu'ils puissent imaginer aimer (sa famille, ses amis, ses amours, l'univers) en toute sécurité. C'est là le cœur de l'histoire, en réalité. Le cœur de l'histoire est la nature du passeport de l'un et de l'autre, de leurs comptes en banque, du fait que l'un a besoin d'un permis pour être auprès de l'autre, tandis que l'autre ne peut quitter plus d'un an ce pays sous peine de tout perdre. Ils sont tous deux régis par une machine coloniale si vieille et profonde et sophistiquée, qu'ils l'ont presque oubliée. L'amour ne triomphe de rien, et certainement pas de cette administration. Gare à vous, si vous l'oubliez. Gare à eux, qui l'ont déjà, et si facilement, oublié.
Leur amour, leurs familles, leurs amitiés, sont gouvernés par un mirador et un papier et un soldat et des cadavres, dedans et dehors. Leurs mondes sont brisés, ou fissurés, ou encore, si vous préférez, en morceaux comme le cœur de Gabriel.
Je compte sur vous, pour vous en rappeler. Je vous parle de deux hommes qui n'ont que des moitiés de droits, des semi-prérogatives, des possibilités toujours négociables et jamais assurées, et qui vivent dans un pays où on les considère, au mieux, comme des citoyens de seconde zone à soumettre, au pire, comme une sous-race, parasites, enfants des ténèbres.
Si vous croyez que j'exagère, vous n'avez qu'à leur demander.
Ce que ça fait, laissez-moi vous le dire : ça fait que dans leur cœur, ou ailleurs dans les organes qu'ils utilisent pour aimer, leur estomac, leurs reins, quelque part au fond d'eux, sont enfouies, dans l'un et dans l'autre, des mines prêtes à exploser pour les rappeler à leur condition primale: voués corps et âme à la désintégration.
Ils le savent, mais aussi ne le savent pas. »
« Ils sont assis à une table, dans un café, penchés sur le portable d'Isaac comme deux conspirateurs préparant une attaque. Isaac boit un café au lait et Gabriel un jus de pomme. « Jus de pomme », c'est l'une des rares et absurdes successions de mots qu'il sait dire dans la langue des autres. Le menu est dans deux langues : une, qui est celle des autres, et l'autre étrangère. Rien, ici, pour leur souhaiter la bienvenue. Alors, être ici, c'est un peu une victoire. Ici, il y en a beaucoup, des autres. Quand il est au milieu d'eux, Gabriel a l'impression d'être un otage de la modernité. Il se sent défait et conquis. Eux, les autres, ne pensent jamais à lui. Mais ils n'en ont pas besoin : ce sont eux qui définissent les termes de sa géographie et de sa vie. Tu ne trouves pas ça malaisant, d'être ici ? demande-t-il à Isaac.
Celui-ci lève les yeux du portable, où il était occupé à tracer un itinéraire dans les cartes empêchées des checkpoints. Non, pourquoi ? Gabriel se rend compte qu'Isaac a réussi, d'une manière qu'il trouve héroïque, inconsciente, à effacer leur toute-puissance de son esprit. Il les gère, eux, leur langue, les checkpoints, les papiers, les soldats, les humiliations, les millions d'impossibles qu'ils leur imposent, comme des broutilles administratives. Il ne remarque pas leur autorité naturelle, ni le confort dont ils disposent et qu'ils manient comme une supériorité sur eux, ni leur fermeté dans la manière de boire leur café, de manger leur glace, d'acheter leur jogging; ni les bottes ni les injures ni la haine. Il s'en fout. À y penser, Gabriel a encore du mal à respirer tant il aime Isaac à ce moment-là. »
« On est libres après tout. On est libres après tout Gabriel. Et quand il répète ça, on est libres après tout, Gabriel se trouve épris de l'odeur de l'inconscience d'Isaac dans cet endroit, de ce qu'il croit être sa liberté irréductible ici et, aussi, de la bouche d'Isaac - pas spécifiquement son haleine, goût café froid et pistache, mais sa bouche toute, odeur de sa langue et de sa respiration et odeur essentielle des muqueuses d'Isaac, son estomac. Qu'Isaac ait voulu aller dans cette maison, sur ce dessin, et qu'il ait fait surgir ce souvenir en lui. Gabriel se dit qu'il a fait le meilleur choix. Qu'ici-bas, il n'était pas possible de faire meilleur choix que d'être avec Isaac, à ce moment-là, fai-sant ce choix-là.
Ils vont partir et il n'y a rien de plus difficile au monde pour Gabriel que de ne pas se perdre dans la bouche d'Isaac, il se retient, mais il voudrait être englouti tout entier par cette bouche, il voudrait être comme l'oncle ou l'arrière-oncle ou il sait plus qui, rôti vif par son désir le plus fou, voilà, il voudrait des fils barbelés autour des jambes et une broche qui le traverse du cul à la bouche et se faire rôtir doucement par les braises de son désir, ça, voilà, c'est tout ce qu'il veut et la bouche d'Isaac lui donne des envies d'anéantissement immenses et irrésistibles, la liberté irréductible c'est quelque chose, l'envie d'être digéré par ses sucs gastriques. »
« Il faut comprendre ce que c'est qu'un check-point abandonné. Il faut voir le triomphe, le lierre qui s'enroule autour des plots, les fourmis qui courent sur le métal, les lézards sur le mirador, les chiens endormis sur l'asphalte. Ça respire lentement, majestueusement, comme une plante. C'est l'anéantissement du pouvoir. Il fait quarante-cinq degrés, la route du désert au désert est vide, et le pouvoir est anéanti; pas partout, et pas pour longtemps, mais ici, juste là, au matin et Isaac ça l'excite d'une manière tout à fait nouvelle, ça l'excite comme on peut bander pour une révolution, c'est très absurde comme réflexion mais c'est à peu près ce qu'il se dit en voyant une porte métallique renversée, les barrières de sécurité en plastique (dégueu rouge et blanc les jours où il fait si chaud ça colle ça brûle) sont à terre, il n'y a personne que lui et Gabriel et le pouvoir anéanti et beaucoup de sueur alors il prend Gabriel par la main et il y a une guérite (couleur indéfinissable, vert pâle en éclosion contre le désert) et ils grimpent la barricade et comme des enfants qui font une bêtise s'accroupissent dans la guérite et disent chut chut chut et puis s'embrassent il fait trop chaud beaucoup trop chaud même pour s'embrasser tout colle tout pique tout brûle et la sueur dans les yeux et leurs cheveux puent tout pue aussi mais c'est plus fort qu'eux car rien n'est plus ridicule, rien plus pitoyable, qu'un check-point où le lierre et les lézards triomphent, rien, mais pareil, trop de sueur, et puis aucune position confortable dans cette guérite mais c'est pas grave c'est drôle c'est surtout ça c'est drôle et on s'esclaffe regarde y a un mirador renversé aussi mais attends, d'abord Gabriel se tient debout sur le rebord de la guérite sur la barricade, défait son pantalon, et pisse partout sur le checkpoint c'est parfaitement ridicule mais Isaac trouve ça génial alors il fait pareil mais comme il bande il pisse partout sans faire exprès et ils s'éclaboussent tous les deux il fait peut-être quarante-huit degrés maintenant et ce checkpoint est vulnérable, loin de tout, c'est bizarre comme parfois les choses ressemblent à des gens par exemple les voitures sont des mecs super agressifs et ça me fait peur, et ce checkpoint, là, à moitié renversé ben je sais pas peut-être à un mais c'est pas sympa de pisser sur un mort. Et après ils s'allongent tous les deux dans la guérite, il y a un peu d'ombre, mais la chaleur et on a laissé la voiture sous le soleil faut qu'on parte on va crever déshydratés là ils disent ça entre deux éclats de rire, un checkpoint abandonné, qui respire de toute sa profondeur, comme une plante, comme le triomphe de tout ce qui est immobile sur la fureur des soldats et des parents des soldats, comme la vengeance du silence et de la lenteur, le géologique qui va avaler tous ces bouts de plastique et de métal, ces choses pathétiques et Isaac rien qu'à y penser, rien qu'à penser à l'anéantissement face à l'éternité a envie d'embrasser Gabriel partout et de rester ici pour toujours. Jéricho est loin à l'horizon et, plus loin encore, la mer Morte, tout est couleur pastel, tout est couleur rose et bleu et ocre mais d'une manière si inouïe dans un air irrespiré de quiconque d'autre qu'eux, les lézards, les fourmis, le chien, que ce gris et vert du checkpoint est encore plus pitoyable ; et ça pue l'urine, la pisse qui s'évapore sur l'asphalte, et les voilà morts de fatigue et assoiffés, bites à l'air, en plein désert, sur un checkpoint pulvérisé, et pour la première fois depuis longtemps ils n'ont pas peur ni l'un ni l'autre et pendant qu'ils rient et halètent et attendent quoi on ne sait pas un lézard rampe lentement près de la jambe d'Isaac, et lui, qui déteste les lézards, hurle et le lézard prend peur et déguerpit et ils rient de plus belle. C'est comme ça que je t'aime, dit Isaac et Gabriel lui répond, de ta bouche aux portes du ciel. »
« car tout peut arriver
tout basculer
quand on est né
comme vous
dans la paume d'un Ifrit.
Tout peut brûler
quand
tout
tient
entre les mains
d'un Ifrit.
Tout peut arriver
quand l'Ifrit
décide
de vous écrabouiller.
Et l'Ifrit,
toujours,
décide ainsi,
car telle est sa nature. »
Quatrième de couverture
Alors qu'un étrange vent de sable ensevelit le pays, deux hommes se croisent chez tante Fátima. Dans Jérusalem, ville labyrinthe, on se séduit chaque nuit en imaginant des histoires de jinns, de lions et de chevaliers.
En cette saison démoniaque, Gabriel et Isaac s'aiment, se perdent et se retrouvent, puis décident, en dépit du sable et des checkpoints, de partir en vacances... Mais n'est-ce pas un projet fou dans un pays morcelé ?
De Jérusalem à Jéricho, puis au mystérieux village où l'on oublie de mourir, jusqu'aux piscines de Salomon, c'est une aventure amoureuse, une recherche de lumière et de liberté.
Karim Kattan, auteur magicien, nous raconte de sa voix enchanteresse le ravissement de Gabriel et d'Isaac dans leur Palestine ardue, baroque et fabuleuse.
Karim Kattan, écrivain palestinien né à Jérusalem en 1989, a grandi à Bethléem. Il est docteur en littérature comparée et écrit en français et en anglais.
Son recueil de nouvelles, Préliminaires pour un verger futur (Elyzad, 2017), a été finaliste du Prix Boccace. En 2021, son premier roman, Le Palais des deux collines (Elyzad poche, 2024) a reçu le Prix des Cinq continents de la francophonie.
Avec L'Éden à l'aube, il confirme la richesse de son univers litté-raire hybride, mêlant oralité et culture classique, réalisme et merveilleux.
Éditions Elyzad, juillet 2024
329 pages
Traduit du suédois par Anna Gibson