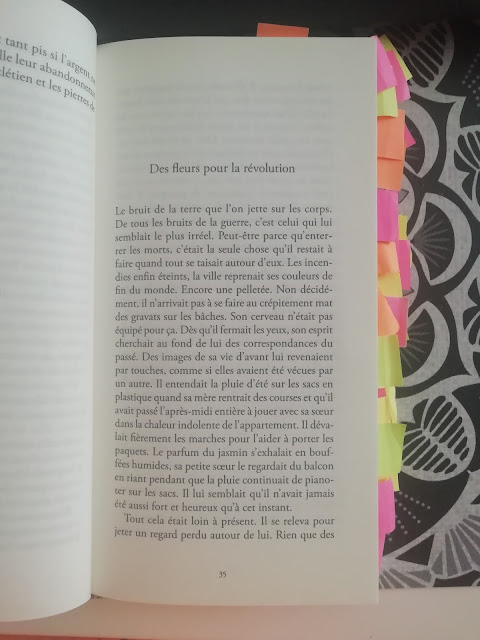La nostalgie du passé. Des protagonistes au mitan de leur vie qui partent à recherche de jours meilleurs. L'amour a déserté leur couple. Les choix faits dans le passé, ont pris, subrepticement, la couleur de l'erreur. Et c'est l'échec qu'ils voient le plus souvent dans le reflet du miroir.
Que l'on se retrouve ou non dans ce schéma, ce petit pavé est convaincant je trouve.
D'aucuns déploreront quelques longueurs. J'en fais partie. D'autres pourront reprocher une lecture un peu trop proche d'une réalité qui les entoure. Je me suis en effet reconnue dans certains traits, mais j'ai aimé lire cette proximité justement. Cela peut avoir ce petit effet rassurant de se sentir moins seuls, ou de se dire, que finalement, pour nous, ce n'est pas si mal ;-)
Rien à redire sur la plume. Tout aussi efficace que dans "Leurs enfants après eux". Il décrit cette France de l'entre-deux et parle des complexes, de l'intersectionnalité tellement bien ! Une écriture qui sonne incroyablement juste.
Les week-ends pluvieux ont du bon, bien entamé un soir de semaine, je l'ai dévoré le week-end dernier ! Parfait !
La nostalgie peut avoir beaucoup de charme, je trouve, quand elle nous pousse vers le bonheur. Quand elle nous donne envie d'en vivre encore et encore de ces bons moments. C'est à cela que j'ai pensé en refermant ce livre. La petite couche de baume qui fait un bien fou !
« Elle redécouvrait [...], comme pour la première fois, ce moment où un enfant sort de l'engourdissement du bas âge, quitte ses manières de bestiole avide et se met à raisonner, faire des blagues, sortir des trucs qui peuvent changer l'humeur d'un repas ou laisser les adultes bouche-bée. »
« [...] Lison la regardait avec un douloureux étonnement. Elle savait bien qu'une civilisation avait vécu avant le web, mais elle avait tendance à renvoyer cette période à des décennies sépia, quelque part entre le Pacte germano-soviétique et les premiers pas sur la Lune.
- Et si , pourtant, soupirait Hélène. J'ai eu mes résultats du bac sur 3615 EducNat, ou un truc du genre.
- Nan ? ... »
« Le temps était passé si vite. Du bac à la quarantaine, la vie d'Hélène avait pris le TGV pour l'abandonner un beau jour sur un quai dont il n'avait jamais été question, avec un corps changé, des valises sous les yeux, moins de tifs et plus de cul, des enfants à ses basques, un mec qui disait l'aimer et se défilait à chaque fois qu'il était question de faire une machine ou garder les gosses pendant une grève scolaire. Sur ce quai-là, les hommes ne se retournaient plus très souvent sur son passage. Et ces regards qu'elle leur reprochait jadis, qui n'étaient bien sûr pas la mesure de sa valeur, ils lui manquaient malgré tout. Tout avait changé en claquement de doigts. »
« Ce soir-là, il tomba sur Les Lacs du Connemara et revit sa mère dans son tablier à fleurs, occupée à écosser les petits pois un dimanche matin, Sardou à la radio pendant qu'il dessinait un château fort, et le printemps par la fenêtre. Puis le mariage de sa cousine, quand il avait vomi derrière la salle des fêtes, une méchante cravate nouée autour de la tête, colorent la terre, les lacs, les rivières. Son père l'avait ramené à l'aube et, au feu rouge, lui avait dit tu fais le grand 8 on dirait. À vingt ans, le même Tam tatam tatatatatam dans une boîte de nuit située aux abords de Charmes, la fumée des Marlboro et Charlie dans l'éclat brumeux des lumières rose et bleu, avant de retrouver le froid piquant des parkings et le retour mortel des voies rapides. Dix ans plus tard au bistrot, sept heures du matin et la voix en sourdine du chanteur tandis qu'il prenait un café au comptoir, la fatigue lourde sous les yeux, à se demander où il trouverait le courage pour venir à bout de cette autre journée. Puis à quarante ans pour finir, un soir de réveillon après avoir déposé le petit chez sa mère, la voix qui scande autour des lacs, c'est pour les vivants, et lui tout seul au volant, ne sachant même pas où dîner ni avec qui, en être là au bout du compte, le cheveu plus rare et sa chemise serrée à la taille, surpris de cette sagesse de vieillard qui, à l'improviste, sur cette chanson roulant son héroïsme de prospectus, le cueillait dans une bagnole qui n'était même pas à lui. Christophe pensa à cette fille qu'il avait voulue à tout prix, et qu'il avait quittée. À ce gosse qui était tout et pour lequel il ne trouvait jamais le temps. Le sentiment de gâchis, la lassitude et l'impossible marche arrière. Il fallait vivre pourtant, et espérer malgré le compte à rebours et les premiers cheveux blancs. Des jours meilleurs viendraient. On le lui avait promis. »
« Il aurait peut-être dû repasser chez lui avant de voir Charlie. Depuis leur séparation, il vivait chez son père, avec le petit quand il en avait la garde. Mais à l'idée de retrouver la grande baraque mal chauffée, l'odeur si particulière de l'âge et des habitudes, en songeant qu'il faudrait une nouvelle fois subir les échos de BFM au fond du couloir et les patins à l'entrée, le courage lui manqua. »
« Elle avait eu dans sa vie des gentils garçons et des intérimaires fumeurs de pet', des allumés de la console, des brutaux ou des zombies comme le père de Bilal qui pouvait passer des heures devant la télé sans dire un mot. Elle avait eu des mecs qui la baisaient vite et mal à deux heures du mat' sur le parking d'un quelconque Papagayo. Elle avait été amoureuse et trompée. Elle avait trompé et s'en était voulu. Elle avait passé des heures à chialer comme une conne dans son oreiller pour des menteurs ou des jaloux. Elle avait eu quinze ans, et comme n'importe qui, sa dose de lettres et de flirts hésitants. On lui avait tenu la main, on l'avait emmenée au ciné. On lui avait dit je t'aime, je veux ton cul, par texto et à mi-voix dans l'intimité d'une chambre à coucher. À présent, Jenn était grande. Elle savait à quoi s'en tenir. L'amour n'était pas cette symphonie qu'on vous serinait partout, publicitaire et enchantée. »
« Ces catéchismes managériaux variaient d'une année à l'autre, suivant le goût du moment et la couleur du ciel, mais les effets sur le terrain demeuraient invariables. Ainsi, selon les saisons, on se convertissait au "lean management" ou on s'attachait à dissocier les fonctions support, avant de les réintégrer, pour privilégier les organisations organiques ou en silos, décloisonner ou refondre, horizontaliser les verticales ou faire du rond avec des carrés, inverser les pyramides ou rehiérarchiser sur les cœurs de métier, déconcentrer, réarticuler, incrémenter, privilégier l'opérationnel ou la création de valeur, calquer le fonctionnement des entités sur la démarche qualité, intensifier le "reporting" ou instaurer un leadership collégial.
Les salariés, continuellement aux prises avec ces soudaines réinventions, ne sachant plus où ils se trouvaient ni ce qu'ils devaient faire au juste, restaient toute leur vie des incompétents chroniques, bizutables à l'envi. Dès lors, dans ces entreprises et ces administrations en perpétuelle mutation, demander une augmentation devenait une démarche quasi mégalomane. Quant aux syndicats, ils devaient faire avec, toujours deux trains de retard sur ces frénésies réformatrices, n'ayant pour eux qu'un peu de bonne volonté, de vagues capacités de nuisance et un passé glorieux qu'ils chérissaient comme une médaille dans un paysage en ruine.
Avec cette fusion des régions, le pouvoir central avait rêvé une fois de plus l'avènement d'une efficacité politique introuvable depuis presque cinquante ans. Mais il fallait pour cela bousculer des baronnies antédiluviennes. Le résultat était à la hauteur des attentes. On voyait partout des habitudes quasi préhistoriques se heurter horriblement dans le chaudron de la nécessaire homogénéisation des pratiques. De petites communautés humaines unies par quelques objectifs, un lieu de travail, une politique salariale et des tickets de resto se découvraient soudain des semblables avec lesquels il fallait s'arranger de gré ou de force, et s'irritaient jusqu'à la haine des frictions qu'occasionnait cet impossible effort de mise en commun. Une secrétaire éclatait soudain en sanglots à son bureau pare ce qu'un chef sans visage venait de lui adresser un mail comminatoire. Un directeur adjoint à bretelles prenait deux ans d'avance sur son ulcère suite à une visioconférence à fleurets mouchetés. Chaque détail devenait l'occasion d'une bataille, chaque privilège acquis ici et inconnu là enflammait les esprits. La moindre singularité devenait le prétexte à des tentatives d'arasement dignes des guerres puniques.
Car avant d'entamer l'œuvre de remodelage, il fallait dresser le cruel inventaire des spécificités locales. Passe-droits sans conséquences, privautés diverses, menues prébendes, incongruités réglementaires donnant droit à un jour de congé ici, à un avantage en nature là, rien ne devait être négligé. Or toutes ces pratiques, hors du droit et pourtant intouchables, outre qu'elles arrondissaient les angles et facilitaient la vie, avaient surtout pour fonction de donner aux salariés le sentiment d'être bien lotis. Une fois l'énumération faite, chacun se comparait. On instruisait dans la foulée le procès des plus favorisés. Entre les directions, le ressentiment enflait vite. On en parlait à la cantine, dans les couloirs. La cafèt' était pleine de ces ruminations scandalisées. La passion d'égalité qui caractérise chaque Français trouvait dans ce travail de recension des droits acquis et des curiosités régionales un détonateur énorme. »
« Une fois de retour dans la cuisine, elle éprouva un immense sentiment de lassitude. À l'étage, le psychodrame se poursuivit une minute ou deux, puis les cris et les cavalcades s'éteignirent. Hélène s'autorisa alors un autre verre. Depuis quand avait-elle l'impression de s'occuper de tout, d'être seule face aux emmerdes ? Évidemment, comme elle et son mec gagnaient pas mal de fric, ils pouvaient s'offrir les services d'une nounou, d'une femme de ménage, apporter les chemises de monsieur au pressing et confier le jardin à une entreprise spécialisée. Mais ça ne changeait rien au fond de l'affaire. Philippe avait une vie supérieure, manifestement plus essentielle, et c'était à elle en définitive que revenait l'intendance. Alors oui, une fois l'an, il débouchait l'évier ou tondait la pelouse, et on en entendait d'ailleurs parler pendant dix jours, mais pour le reste, il s'épargnait le gros des menues tâches qui maintenaient le navire familial flot. Ils en avaient bien sûr discuté, on était entre gens ouverts et modernes, et Philippe lui avait toujours donné raison. Les preuves de ses efforts et de son empathie ne manquaient pas. Mais à la fin, comme ce soir, elle gérait toute seule. Elle se mettait en colère et le regrettait. Elle maltraitait ceux qu'elle aimait et n'y pouvait rien. »
« Le taf, les parents, les gosses, l'amour, l'intime merdier qui ne va jamais bien pour qui que ce soit. »
« Alors voilà. On faisait des mômes, ils chopaient la rougeole, et tombaient de vélo, avaient les genoux au mercurochrome et récitaient des fables et puis ce corps de sumo miniature qu'on avait baigné dans un lavabo venait à disparaître, l'innocence était si tôt passée, et on n'en avait même pas profité tant que ça. Il restait heureusement des photos, cet air surpris de l'autre côté du temps, et un Babyphone au fond d'un tiroir qu'on ne pouvait se résoudre à jeter. Des jours sans lui, des jours avec, l'amour en courant discontinu. Mais le pire était encore à venir. »
« L'adolescence est un assassinat prémédité de longue date et le cadavre de leur famille telle qu'elle fut gît déjà sur le bord du chemin. Il faut désormais réinventer les rôles, admettre des distances nouvelles, composer les monstruosités et les ruades. Le corps est encore chaud. Il tressaille. Mais ce qui existait, l'enfance et ses tendresse évidentes, le règne indiscuté des adultes et la gamine pile au centre, le cocon et la ouate, les vacances à La Grande-Motte et les dimanches entre soi, tout cela vient de crever. On n'y reviendra plus. »
« Un consultant, c'est un mec qui t'emprunte ta montre pour te dire l'heure et qui se tire ensuite avec la montre. »
« Les mauvaises langues avaient surnommé l'endroit turkishland, sans qu'on sache très bien si cette appellation était liée à l'origine de certains habitants ou à la nationalité de ceux qui l'avaient bâti. Quoiqu'il en soit, le lotissement s'était étendu comme une flambée d'urticaire, parti de rien et couvrant bientôt des hectares de terrain viabilisé. On trouvait là des dizaines de pavillons, en général modestes et de plain-pied, parfois significativement mégalos, avec une tour et des statues à l'antique sur la pelouse, et qui s'alignaient tous le long de voies aux noms hétéroclites. Au printemps, des maisons enrubannées de glycines et croulant sous les rhododendrons s'armaient pour d'improbables concours de fleurissement toujours remportés par les mêmes. Des piscines démontables occasionnaient à la belle saison des nuisances et des joies. Le soir, l'odeur des barbecues montait flatter les narines de dieux indifférents et l'on trouvait dans chaque garage une tondeuse et une table de ping-pong. »
« Au fond, les vielles amours étaient comme ces tapisseries décaties aux murs des châteaux forts. Un fil dépassait, vous tiriez dessus par jeu, et tout se détricotait dans la foulée. En un rien de temps, il ne restait plus que la trame, les manies et les névroses à découvert, le rêve agonisant en ficelles sur la moquette. Et pour remédier à la chose, les psys n'étaient d'aucune utilité, leur replâtrage narcissique restait vain. Aucune cure ne pouvant rapiécer ces loques. Il aurait fallu pour bien faire revenir en arrière, effacer ces vingt années de vérité en retard qui venaient de vous exploser en plein visage. »
« À l'adolescence, aimer relevait de l'évidence. Une meuf passait, vous la trouviez belle à crever. Dès lors, chaque fois que vous la croisiez, c'était les mêmes symptômes, mal au bide, les mains moites, incapable de dire trois mots, et puis que ça en tête, la maladie totale. Vous maniganciez des plans déments pour lui parler. Le soir en secret, vous écoutiez de la musique au casque en vous faisant des films. Finalement, vous finissiez par l'aborder, et si vous ne vous preniez pas un râteau direct, débutait la période des points communs. C'était fou les coïncidences tout à coup, les passions partagées, les haines identiques. On s'étonnait d'avoir pu exister l'un sans l'autre alors qu'on était Gémeaux à tel point. On se tenait la main, on se cherchait dans la cour et, avec un peu de chance, on finissait par coucher et puis d'un jour à l'autre, pschitt, les choses se dégonflaient pour recommencer plus loin. L'amour était tragique et temporaire. Le désir infini mais lisse. On appartenait alors à un monde aménagé pour soi, plus ou moins. »
« Enfin la voix de Sardou, et ces paroles qui faisaient semblant de parler d’ailleurs, mais ici, chacun savait à quoi s'en tenir. Parce que la terre, les lacs, les rivières, ça n’était que des images, du folklore. Cette chanson n'avait rien à voir avec l'Irlande. Elle parlait d’autre chose, d’une épopée moyenne, la leur, et qui ne s'était pas produite dans la lande ou ce genre de conneries, mais là, dans les campagnes et les pavillons, à petits pas, dans la peine des jours invariables, à l’usine puis au bureau, désormais dans les entrepôts et les chaînes logistiques, les hôpitaux et à torcher le cul des vieux, cette vie avec ses équilibres désespérants, des lundis à n'en plus finir et quelquefois la plage, baisser la tête et une augmentation quand ça voulait, quarante ans de boulot et plus, pour finir à biner son minuscule bout de jardin, regarder un cerisier en fleur au printemps, se savoir chez soi, et puis la grande qui passait le dimanche en Megane, le siège bébé à l'arrière, un enfant qui rassure tout le monde: finalement, ça valait le coup. Tout ça, on le savait d'instinct, aux premières notes, parce qu'on l'avait entendue mille fois cette chanson, au transistor, dans sa voiture, à la télé, grandiloquente et manifeste, qui vous prenait aux tripes et rendait fier. »
Quatrième de couverture
Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite ville de l’Est de la France. Elle a fait de belles études, une carrière, deux filles et vit dans une maison d’architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir.
Et pourtant le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu.
Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n’est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain les grands efforts, les grandes décisions, l’âge des choix. Aujourd’hui, il vend de la bouffe pour chien, rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, vit avec son père et son fils, une petite vie peinarde et indécise. On pourrait croire qu’il a tout raté.
Et pourtant il croit dur comme fer que tout est encore possible.
Connemara c’est cette histoire des comptes qu’on règle avec le passé et du travail aujourd’hui, entre PowerPoint et open space. C’est surtout le récit de ce tremblement au mitan de la vie, quand le décor est bien planté et que l’envie de tout refaire gronde en nous. Le récit d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi.
Éditions Actes Sud, 2022
396 pages