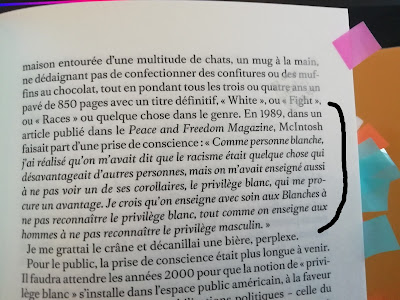Ouvrir Les parts oubliées, c'est embrasser le parcours de vie d'une nageuse hors-pair originaire d'une des îles des Caraïbes, dans la seconde moitié du vingtième siècle ; un parcours comme dans un grand-huit, un parcours de survie. Vertigineux. Fait de chutes libres. De choix qui coûtent, de décisions effroyables, d'abandons, de déshérences, de trahisons. Une vie tourmentée, modelée par la violence. Et puis l'Amour. Un amour retrouvé qui "balaie toute la poussière de son cœur " et lui fait toucher du doigt le bonheur. Un semblant de bonheur. Une illusion in fine. Le terrain est glissant ; il y a les non-dits qui empoussièrent les cœurs, les secrets dormants... Alors quand arrive le moment de regarder derrière soi, il est temps de s'affranchir de ses mensonges et de s'atteler à la recette de l'amour et cuisiner un dernier gâteau noir.
L'histoire de cette femme et de sa famille sur trois générations - "une famille afro-américaine d'origine caribéenne, un clan d'histoires oubliées et de cultures aux contours vagues" -, nous est contée d'une bien belle façon. Le livre débute par des instants, des bouts de vies semés au gré des premiers chapitres et puis, petit à petit les liens se tissent, tout s'éclaire et nous voilà, embarqués dans le tourbillon de la vie ; témoins du combat d'une femme pour rester digne et vivre en occupant sa propre place, "une femme qui ne pouvait pas s'autoriser un passé".
Une belle saga familiale qui aborde de nombreux thèmes : l'immigration, le racisme, l'éducation, la condition des femmes, le patriarcat, la différence, le deuil, la fuite, les traditions, la transmission, l'identité, l'amitié, l'amour évidemment, la peur aussi. Cette peur de l'inconnu, infondée bien souvent (cela n'engage que moi ;-)) qui éloignent les êtres. « Que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. » conseillait Nelson Mandela.
J'ai aimé cette lecture, non linéaire. Qui m'a surprise, mise en colère, émue aux larmes.
Qui m'a poussée à réfléchir sur mes propres choix, mes silences.
Il n'est pas toujours évident d'être là pour les gens qu'on aime.
Rentrée Littéraire, disponible le 24 août 2023 en librairie.
Merci aux éditions Buchet.Chastel pour cette belle découverte !
« Et la vie d'une personne, comment la cartographier? Les frontières que les gens érigent entre eux et les autres. Les cicatrices laissées sur les parois du cœur. »
« Avant, je pensais que c'était parce qu'on était noirs, reprend Benny. Que nos parents voulaient qu'on réussisse, qu'il nous fallait travailler deux fois plus dur, être au-delà du reproche. Aujourd'hui, je comprends. Il fallait qu'on soit parfaits pour mieux cacher que notre famille est construite sur un immense mensonge. »
« En cinquante ans, l'époque avait changé. Les adoptions forcées avaient fait la une des journaux télévisés. On voyait des femmes grisonnantes comme Eleanor embrasser leur enfant biologique, le visage couvert de larmes. On avait exigé du gouvernement qu'il demande pardon. Quelqu'un en avait même fait un film. »
« - Certaines personnes pensent que le surf, c'est une relation qui se tisse entre toi et la mer, lui dit sa mère un jour que Byron se débattait avec sa planche. Mais le surf, en réalité, c'est une relation qui se tisse entre toi et toi-même. La mer, elle fait ce qu'elle veut. »
« - [...] la tradition nous dit parfois que seules certaines personnes peuvent étudier certains sujets, ou participer à tels sports, ou jouer dans un orchestre, ou je ne sais quoi, mais la tradition se limite à ce que les gens d'avant ont fait ou pas; ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont capables de faire. Ni avec ce qu'ils feront plus tard. »
« Voilà ce que j'aimerais vous dire. Dans la vie, il faut prendre la vague et la chevaucher. Alors, que faire s'il n'y a pas de bonnes vagues dans votre coin? Eh bien, il faut aller la chercher. Et ne jamais cesser de la chercher, d'accord ? Une solution, c'est de poursuivre ses études. Ne sous-estimez pas l'importance d'une bonne éducation. Parce que vous ne pourrez pas gagner... »
« Quand les gens ne comprenaient pas quelque chose, ils se sentaient souvent menacés.
Quand les gens se sentaient menacés, ils devenaient violents. »
« Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide ? Pourquoi nous, les femmes, laissons-nous la honte prendre le pas sur notre bonheur? Je pensais que les choses avaient évolué depuis mon enfance, mais, apparemment, pas assez. »
« Lorsque le téléphone sonna, Marble était allongée sur un transat et observait un iguane. Elle pensait qu'elle avait eu raison de venir sur cette plage, loin de tout. Bien qu'elle ait essayé, elle n'avait pas réussi à faire taire ses doutes sur ses parents et ses origines. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin d'être quelque part où personne n'attendrait rien d'elle. Cet endroit était parfait. Elle le sut à l'instant où elle vit cet œil noir luisant la fixer depuis l'arbre. Pendant qu'elle le regardait, l'iguane fit ses besoins qui tombèrent sur le sable, près de son visage, mais le caca, ça ne dérangeait pas Marble.
C'était une œuvre d'art, l'immobilité de cette créature, ses doigts longs et fins agrippant le tronc, cette crête sur son dos. Marble déporta son regard vers les vagues turquoise qui rampaient sur le sable blanc, inspira l'odeur de noisette émanant de sa peau qui chauffait au soleil, [...]. »
« Ne pas avoir de réponse, c'était normal. Voilà ce qu'ils étaient, une famille afro-américaine d'origine caribéenne, un clan d'histoires oubliées et de cultures aux contours vagues. »
« Avec le temps, Eleanor Bennett n'a cessé de renoncer à des morceaux d'elle-même, si bien qu'à la fin il ne restait plus grand-chose. Famille, pays, nom, même un enfant. Et elle ne s'était pas sentie en mesure de nommer ces pertes. Benny et Byron n'auraient jamais été en mesure de combler les trous persistants, si?
Benny et Byron n'avaient jamais suffi. »
« Il pose sa main sur la sienne et le contact avec sa paume, chaude et sèche, balaie toute la poussière de son cœur. »
« [...] alors qu'elle espérait que son monde s'ouvrirait enfin au-delà de l'étouffement de l'adolescence, elle avait découvert que les cases où elle pensait entrer - que ce soit celles de la race, de l'orientation sexuelle, des penchants politiques - réduisaient en fait son monde. »
« Benedetta, dans la lettre que tu m'as envoyée, tu disais que tu ne pensais pas que je comprendrais les raisons de ton silence, mais évidemment que je comprends. Tant de vies ont été modelées par la violence, bien plus qu'on n'aimerait penser. Et tant de vies ont aussi été modelées par le silence, bien plus qu'on n'aimerait penser. Quand je suis tombée enceinte de ta sœur, c'était contre ma volonté et aucun de mes proches n'en a jamais rien su, jusqu'à maintenant. Il fallait aussi que je l'empêche de découvrir la vérité. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis laissé convaincre de renoncer à elle.
Et puis j'avais honte. Ce qui m'était arrivé m'avait complètement prise par surprise. Je pensais travailler dans une entreprise respectable, avec un employeur généreux. Je pensais être en sécurité. »
« [...] ne va pas penser que prendre la fuite, t'éloigner des autres, suffit pour réussir sa vie. Ça ne doit pas être une solution de facilité en cas d'ennuis. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que ma vie a été autant déterminée par la méchanceté des gens que par leur gentillesse, leur attention et leur écoute. Et c'est en ça que ton père et moi t'avons failli. Tu n'as pas trouvé suffisamment de cette bienveillance dans notre maison pour oser y rester. »
« Est-il interdit aux gens noirs en Amérique d'avoir des mains ?
Byron aimerait croire que cette épidémie de maltraitance, ces brutalités envers de jeunes Noirs américains sans défense, ce n'est que ça : une épidémie, certes longue, mais qui peut être maîtrisée. Il veut continuer à croire aux officiers de police, il veut respecter les risques qu'ils prennent, sachant que, chaque jour, ils pénètrent en territoire inconnu. Il veut savoir qu'il peut décrocher son téléphone et appeler la police s'il en a besoin. Il y a beaucoup de colère qui monte. Beaucoup de souffrance. Où vont-ils tous finir - Noirs, Blancs, tous les autres - si la situation ne s'améliore pas ? Que dirait son père, s'il savait que ça se passe encore comme ça aux États-Unis en 2018 ? Une pensée soudaine le traverse, une pensée blasphématoire : peut-être est-ce mieux que son père ne soit plus là, qu'il ne sache pas. »
« Byron estime que la voie royale du militantisme, c'est de grimper l'échelle sociale, d'accumuler des biens, d'exercer son influence au cœur du pouvoir. Mais Lynette lui explique que ce n'est pas tant une manifestation qu'une veillée, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de Jackson. Pour tous ces gens qui n'ont pas survécu à une arrestation de routine. Pour tous ceux qui sont encore en deuil. Dont nous, dit Lynette. On doit se donner l'autorisation de faire notre deuil, de s'éclaircir les idées, continue-t-elle, pour pouvoir ensuite retourner dans les mairies, les tribunaux, les conseils d'administration et les salles de classe, et provoquer des changements. »
« Etta pourrait se dire qu'elle a élevé deux beaux enfants gentils et généreux, qu'elle a déjà fait le plus important dans une vie, mais elle sait que ça ne suffit pas pour elle. Quand elle était enfant, Etta pensait qu'elle méritait toutes les bonnes choses qui lui arrivaient. Elle ne voyait pas pourquoi ses rêves devaient être plus petits que ceux des autres simplement parce qu'elle avait grandi sur une île. Ça n'a pas changé, mais, à chaque année qui passe, elle prend la mesure de la chance qu'elle a eue. Ça aurait pu se passer bien différemment pour Etta Pringle, et elle a toujours une dette à rembourser au monde. »
Quatrième de couverture
« B&B, il y a un petit gâteau noir dans le congélateur pour vous. Ne le jetez pas. Je veux que vous vous asseyiez ensemble et que vous partagiez ce gâteau. Vous saurez quand le moment sera venu. Je vous aime, Ma. »
Ce sont les dernières volontés de la mère de Byron et Benny. Avec le gâteau, elle a laissé un enregistrement audio réalisé avant sa mort. Elle y livre l'histoire d'une jeune nageuse venue d'une île des Caraïbes, forcée de quitter son pays natal après avoir été accusée de meurtre. Alors que son récit se développe, le frère et la sœur découvrent les multiples strates du secret qui entoure leur arbre généalogique et les conséquences sur leur vie tout entière.
Dans un voyage bouleversant qui emmène le lecteur des plages des Caraïbes au Royaume-Uni en passant par l'Italie, Charmaine Wilkerson explore ce qu'on laisse derrière soi pour survivre, l'importance de l'héritage et de la transmission, et les parts du passé que l'on soumet au silence.
« Un premier roman tentaculaire, vibrant, qui nous fait croire aux secondes chances. »
New York Times
Éditions Buchet.Chastel, août 2023
508 pages
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile Chartres