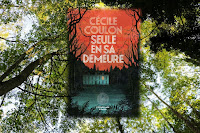Merci Baptiste Beaulieu. Aucune raison de demander pardon.
Vos mots sonnent si vrais, si justes.
Écouter. Savoir écouter son prochain. Savoir écouter les silences aussi. Cela devrait être enseigner à la fac, oui !
« Les gens sont souvent passionnants, leur histoire est précieuse, car il n'y en a jamais une pour ressembler à l'autre ! »
Vos patients ont beaucoup de chance.
Vous donnez du sens à ce que vous faites.
En partageant vos doutes, vos réflexions sur le sens de la vie notamment, vous m'avez touchée. Émue aux larmes ✨️
Vos larmes, aussi sèches soient-elles sont des larmes d'humanité !
« Ce n'est pas déshonorant, comme métier, d'aider les gens à se sentir de temps en temps un minimum vivants. On ne nous enseigne pas non plus à la fac que certains patients viendront vous voir toutes les semaines. Le jour où le docteur ne sera plus remboursé, ils ne viendront plus et, dans leurs têtes, ils existeront moins. Ceux qui ont les moyens iront chez le coiffeur. C'est terrible, quand tu comprends ça. Terrible. »
« Ce qu'il faut, c'est qu'on soit naturel et calme Dans le bonheur comme dans le malheur, [...]
Et, à l'article de la mort, Se souvenir que le jour meurt, Que le couchant est beau, et belle la nuit qui demeure. Puisqu'il en est ainsi, ainsi soit-il...»
Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeaux et les autres poèmes d'Alberto Caeiro - Poésies d'Alvaro de Campos, traduit du portugais et préfacé par Armand Guibert, «Poésie», Gallimard, 1987.
« Une polyarthrite, une fibromyalgie, un viol même, ça ne se vidange pas, ça ne s'extrait pas. « Matez-moi ce morceau, madame! On l'a enfin eue, votre boulimie ! » Et, sous le regard dégoûté mais soulagé de la patiente, flanquer le tout à la boîte à ordures, enfermé dans un mouchoir. On ne peut pas mettre la schizophrénie à la poubelle. On ne peut pas rabattre le couvercle sur tout ce qui heurte, blesse, gonfle, irrite, gratte, coule trop, ne coule pas, s'enflamme, etc. Impossible. Sinon quelqu'un en aurait déjà fait un business, c'est certain. Et je ne serais pas devenu médecin mais «videur de gens», comme certains vident les truites. Quel chasseur se cache en moi! Un trappeur, toujours en quête d'un furonculé! D'un échardé! D'un constipé! À deux doigts de me poster au rayon jus de pruneau et Hépar du Casino pour distribuer mes cartes de visite! J'aime les furoncles parce qu'ils me pro-curent une satisfaction immédiate, visible, palpable. Matérielle. »
« On ne devrait pas mourir sans en avoir l'âge. »
« Bref... Un froid, mais un froid ! À faire péter les tuiles des toits. Le temps du chagrin, je vous dis. Je me souviens de mes cours de médecine, comme quoi on attrape la fièvre par les extrémités, mais c'est rigoureusement faux: je vais mal, très mal, et ce n'est pas par les extrémités qu'elle arrive, ma pneu-monie, c'est par le cœur. Ça prend toute la place parfois, le cœur. Saleté de cœur ! »
« Double peine: tu ne sais plus pourquoi tu dois vivre dans un monde où l'amour peut tuer un gosse, et en plus tu te retrouves à servir de Courtepaille à une tribu de morbaks affamés. Buffet à volonté ! Dieu n'existe pas, pas plus que les vraies bonnes affaires ! La vie ne fait pas de cadeaux, ou alors ils sont toujours un peu empoisonnés. »
« Ma chance? Ne jamais avoir croisé dans les cou-loirs la famille du patient qui venait de rendre les clefs de sa vie. Parce qu'elle était là évidemment, la famille, quelque part derrière ces murs blancs, et susceptible d'entendre mon «Super» lancé avec la plus effrayante sincérité du monde.
Et moi de quitter définitivement l'hôpital deux mois plus tard parce que, eh quoi, je veux soigner! Pas jouer aux chaises musicales avec les vivants et les morts. Plus jamais je ne veux :
- réduire un patient à sa pathologie,
- me réjouir de la mort de quelqu'un.
Ce n'est pas pour cela qu'on devient soignant.
Certes, on ne peut pas sauver tout le monde, mais je suis, à cette heure de ma vie, trop jeune pour me ranger à cette idée. Ce merdier géant, cette poudrière hospitalière, nous sommes censés y incaner un certain idéal de vocation, d'humanité et de civilisation. »
« C'est juste un rêve mais il est plus réaliste que l'autre, celui où les hommes arrêteraient de taper des femmes. Faut vraiment rêver petit quand on est sur Terre: on minimise les risques d'être déçu. »
« Avant j'avais aussi un site Internet, avec adresse et horaires du cabinet. Nous l'avons supprimé avec mes associés. Trop de patients, mais même comme ça on déborde. Nous vivons dans un pays où les médecins se cachent pour survivre à leur journée de travail: de notre profession, cela ne dit rien, de ceux qui nous dirigent, cela dit tout.
Parfois, les patients poireautent dans le patio quand la salle d'attente dégueule. Une fois, la locataire du dessus, qui travaille à domicile comme traductrice pour l'ONU, s'est plainte de « la faune ». Une fois, encore, elle a jeté un seau d'eau glacé en plein hiver sur ce vieux M. Grimaldi qui s'était trompé d'interphone.
Trois semaines après, j'ai averti par écrit la locataire que ce patient, leucémique, était « malheureusement décédé d'une pneumonie contractée après le coup du seau d'eau ».
Ce n'était pas vrai, mais ça aura eu le mérite de la faire réfléchir. Elle s'est excusée et je l'ai traitée de connasse. Pour la beauté du geste. Je pense qu'elle aurait souhaité qu'on ne soigne que des vieilles dames à collier de perles. Mais on soigne tout le monde, du bourgeois au toxico, du gitan au col blanc, du vieillard au bambin, et du bobo au punk à chien - même qu'il m'est arrivé de soigner le chien !
À vrai dire, une connasse traductrice pour l'ONU, on la soignerait aussi. »
« Je ressemble à l'image qu'on pourrait se faire d'un médecin de famille. Je fume trop, mâche des chewing-gums à la menthe et j'ai des mocassins à glands, vous voyez ? Un médecin de famille, quoi, un vrai de vrai. Un matin, je suis sur mon vélo, beau comme Bellérophon sur Pégase, je quitte le domicile d'une patiente que son mec a confondue avec un punching-ball, je suis distrait, pense à cette guerre invisible que mènent les hommes contre les femmes et à un poème que je suis en train d'écrire, et j'ai aussi très envie de parachuter un gothique: c'est l'effet café + vélo + froid matinal, ça réveille un besoin urgent (faudrait réaliser une étude scientifique sur le sujet). Je pédale vite car je veux arriver au cabinet médical avant que des patients fassent la queue devant la porte d'entrée (c'est plus com-pliqué de se soulager avec dix souffrants en salle d'attente). Bref, guerre + poème + impératif naturel, je manque de percuter un autre vélo et, comme j'ai plus de sonnette (la vieille a été volée), je me surprends à faire « BLING BLING ! » avec la bouche. Je veux vraiment imiter une sonnette de vélo, mais j'ignore pourquoi, je ne crie pas « DRING DRING ! ». »
« Je ne sais par quels étranges chemins sa glycémie est inversement proportionnelle au degré d'attention que j'arrive à lui accorder. Elle a besoin d'être palpée, auscultée, pesée, mesurée en long en large et en travers. Et par-dessus tout : elle a besoin de parler, Mme Chahid. D'être écoutée. Plus je l'écoute au cabinet médical, meilleurs sont les résultats de sa prise de sang. Les voies du soignant sont impénétrables... »
« Au tout début de mon installation en ville, j'ai envie de lui dire, à Mme Chahid comme aux patients qui flanchent : « Courage, tenez le cap, ça en vaut le coup », mais je ne sais pas trop ce que j'entends par là.
« Ça », c'est l'odeur des pavés après la pluie en été.
« Ça », c'est la ville déserte et silencieuse au milieu de la nuit. « Ça », c'est les étoiles qu'on regarde en forêt avec des amis (ou seul, ça marche aussi). « Ça », c'est votre deuxième fils qui vous masse les pieds le soir.
« Ça », c'est le sel de la vie.
Mais ce ne serait pas très utile, je pense. Les gens comme Mme Chahid ne viennent pas à la consultation pour écouter ce que j'ai à dire: la plupart d'entre eux viennent juste pour parler. Se confier à un autre être humain. Moi ou un plombier, ça ne changerait pas grand-chose. Alors je hoche la tête et j'écoute. Faut bien quelqu'un pour s'y coller. Si demain on obtient le même résultat avec une silhouette de docteur découpée dans du carton, je resterai dans mon lit. Néanmoins, personne n'obtiendra le même résultat, et pour une bonne raison: pour le patient, c'est pas tout de vider son sac, il faut que le docteur en face s'intéresse à lui, à ses mystères, ceux dans la tête, ceux dans les artères, et ceux « devant-derrière qui lui font de l'air ». Ça manque vraiment aux gens, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à eux. Juste de temps en temps.
Les dix années d'études de médecine ne servent quasiment à rien d'autre. Mais motus: nul ne vous aura averti sur les bancs de la fac. On vous fait miroiter le statut social. Le prestige. Vous allez sauver des vies. Vous ne vous lèverez pas pour des queues de cerise ! Même que le soir, dans le miroir de votre salle de bains, vous vous direz : « J'ai été utile. J'en ai aidé combien ? »»
« Ce n'est pas déshonorant, comme métier, d'aider les gens à se sentir de temps en temps un minimum vivants. On ne nous enseigne pas non plus à la fac que certains patients viendront vous voir toutes les semaines. Le jour où le docteur ne sera plus remboursé, ils ne viendront plus et, dans leurs têtes, ils existeront moins. Ceux qui ont les moyens iront chez le coiffeur. C'est terrible, quand tu comprends ça. Terrible. »
« On cherche tous une vérité. Ce qui nous manque. J'en sais rien. D'ailleurs, je ne sais rien du tout. Seulement qu'elle est affreuse en tout point, cette histoire. La maladie de M. Soares, avec ses perles de sang semées partout, le handicap de Mme Soares avec ses radiographies compulsives, l'appartement minuscule, les voisins minables, la barre d'immeuble atroce, peut-on faire plus misérable ? Leur vie, c'était une réunion du pire et de l'insupportable. Un résumé de l'enfer... Puis je me souviens qu'ils vivaient ensemble. Que sa femme l'aimait. Qu'il aimait sa femme. Ils ont eu au moins ça. Tout le monde ne peut pas en dire autant, et c'est sans aucun doute encore plus affreux, la vie, quand tu ne peux pas en dire autant. »
« Nouveau mouchoir. Qu'est-ce que ça me coûte en mouchoirs, la médecine générale! Dans mon bureau, on pleure à cause du petit caporal qui nous sert de patron, on pleure à cause du temps qui passe, on pleure à cause du corps qui fait mal, on pleure parce qu'on a fait mal à son corps, on pleure parce que la personne qu'on aime est partie aimer quelqu'un d'autre, on pleure parce que ceux qu'on aime s'en vont parfois d'où l'on ne revient pas. Dans ce cas, pleurer est comme leur adresser un ultime appel : Ne partez pas là-bas ! Mais ils partent. Et les larmes n'ont servi à rien. Les larmes, c'est un truc inutile contre la mort, mais qu'on n'a jamais cessé d'essayer quand même.
Ça va aller, monsieur Soares. Je suis sûr que vous allez y arriver ! Courage !
Y arriver ? Il me dit qu'y arriver, ça voudrait dire l'oublier et qu'il ne veut pas l'oublier, sa Charlotte, même un peu. D'après lui, c'est juste des mots comme ça, pour se débarrasser du problème. On ne se sort pas de tout dans la vie, il y a des blessures incurables, et, la prochaine fois, je ferai mieux de la fermer. Quant au courage, là n'est pas la question: il n'a pas le choix. C'est ça ou se laisser partir. »
« Je me sens stupide. On a tellement de phrases qui ne servent à rien dans la vie, qui meublent le vide laissé par l'éternelle vérité : on naît seul, on vit seul, et on est toujours seul à mourir. Avec des lacs de larmes plus ou moins étendus, et plus ou moins profonds.
Ça empêcherait de dormir, de savoir ça. Faudrait même pas le dire à haute voix. Que ça reste un secret entre adultes. »
« Bref, la peur, la peur, la peur, il y en a pour tous les goûts et pour tous les jours.
Quand est-ce qu'on arrête d'avoir peur? »
« Ou alors, plus simplement : « Le docteur aime bien les êtres humains, mais se méfie des hommes. Il sera du bon côté. » Elles se trompent : je ne me méfie pas des hommes, je les juge. Sévèrement. Et pour cause : j'en suis un. Je sais de quoi je parle ! »
« Les gens sont souvent passionnants, leur histoire est précieuse, car il n'y en a jamais une pour ressembler à l'autre ! »
« Je pourrais ne pas vous avertir. Parler comme si de rien n'était et dans quelques pages vous assé-ner cette mort d'un coup d'un seul, mais on n'est pas là pour ça. JE ne suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières avec des histoires de chasse. Je dis juste ce que je vois. C'est dur, parfois, de dire ce que l'on voit. Mais un truc encore plus dur, c'est bien de voir ce que l'on voit. Quand on entre chez les gens, que ces gens sont malades, qu'ils s'accrochent à votre blouse et placent en vous tout leur espoir, on voit. Quo i? Nous. Tous dans notre vérité nue. Et c'est violent. Âpre. La « condition humaine », c'est bien l'expression la plus antinomique au monde, appelez-moi ça la condition inhumaine! Je refuse d'accepter la totalité du réel, je plaide coupable. Alors je fourre de la poésie où il ne faut pas, peut-être même comme il ne faudrait pas, mais c'est vrai que c'est facile, la poésie: pas besoin d'avoir appris. »
« « C'est quand, la dernière fois qu'on a fait une prise de sang, Josette ?»
Je viens de poser ma question sans vraiment y penser. Elle n'était pas prévue au programme. Et si je ne l'avais pas posée ? Et si nous n'avions pas programmé cette prise de sang ? Peut-être ne serait-elle pas morte. Peut-être qu'elle aurait eu « plus de temps ». Que sa vie ne serait pas passée à toute vitesse. Peut-être que le cancer est réapparu à partir du moment exact où j'ai tamponné l'ordonnance pour sa prise de sang... CHLACK! Et HOP! Un laissez-passer pour la mort! Paraît que la Lune n'existe pas si on cesse de la regarder...
À quoi ça tient, le destin ?
Est-ce que je ne surestime pas mon rôle dans toute cette putain d'histoire ? Personne n'a le pouvoir de faire apparaître un cancer chez les gens, hormis le radium sans doute, mais on n'a jamais vu de radium en blouse blanche. »
« Le monde, je l'ai vu parler un jour à travers Miran, un enfant syrien de onze ans que je ren-contre au cabinet médical en soignant son papa. Ses parents sont réfugiés. Quand Miran entre au cabinet, il me prend dans les bras comme si nous étions amis de longue date et me serre fort contre lui. Les patients en salle d'attente sourient, un peu gênés. Moi, je reste les bras ballants, lui tapote l'épaule, sans savoir comment réagir. C'est la première fois qu'on se voit, petit, fais pas ça! Ses parents, aidés d'une traductrice, m'expliquent que Miran souffre d'un handicap mental léger. Il est toujours ainsi, même avec les inconnus.
Pendant que tout ce petit monde s'installe à mon bureau, le gamin commente, tout sourire, les objets qu'il voit en les pointant du doigt. Il a l'air heureux de tout, je ne comprends rien. Mais ça me va. La traductrice raconte : la fuite depuis leur ville natale, les longs trajets en camion, les nuits sans dormir, la faim, la soif, le froid, la peur au ventre, la traversée périlleuse de la Méditerranée, les passeurs, l'argent qui circule de main en main, les humiliations, la Faucheuse omniprésente.
Pendant l'entretien, Miran est perché sur la table d'examen où il a grimpé tout seul. Il s'y balance d'avant en arrière, en chantonnant. Moi, sur le côté, je ne pipe rien, je ne parle pas syrien, mais elle est incroyablement belle, cette berceuse. À la fin, alors que l'oisillon Miran est encore sur sa branche, je me permets de demander aux parents :
C'est beau. On dirait une prière ou un poème... Elle signifie quoi, cette chanson ?
La traductrice m'explique. Miran ne chante pas. Il récite. Quand Miran se sent à l'aise, il aime s'asseoir et réciter la liste de toutes les personnes qu'il a rencontrées depuis qu'il est né. Il les connaît toutes par cœur! À force de répéter leurs prénoms! Tous les jours, il en ajoute de nouveaux. Tous ceux qui croisent sa route depuis sa naissance dans un pays en guerre jusqu'à son arrivée dans un pays en paix.
Une liste immense. Des visages. Des dizaines de visages. Qu'il honore. En chantant leurs prénoms. Il commence toujours par ceux des personnes de son quartier d'enfance. Combien de morts parmi ces noms-là ? »
« On met deux ans à apprendre à parler, mais faut toute une vie pour apprendre à se taire. »
« Peut-être que, parfois, le réel est tellement fort que la fiction paraît la solution ? Peut-être parce qu'une part de moi refusait d'admettre devant le patient que j'ignorais totalement comment l'aider ? »
« Mon métier, c'est gratouiller dans la nature humaine. Dans ce qu'elle a de meilleur comme dans ce qu'elle a de pire, mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui t'expliquent que c'est dans le pire qu'elle est la meilleure. Globalement, je crois qu'on bataille tous comme on peut, et qu'on est tous paumés. D'une façon ou d'une autre, qu'on sache ou non pleurer. »
« C'est indicible, ce qu'elle traverse, ce moment final où le corps et l'existence nous font comprendre qu'il va bientôt falloir rendre les clefs.
Au fond, elle voudrait arrêter de mourir. »
« Oui, j'en reviens à la gestion de la colère: vous n'imaginez pas comme c'est difficile, quand on va chez un malade toutes les semaines, qu'on s'échine à fourrer par-ci, par-là du confort fondamental, oh pas grand-chose, du petit plaisir basique, élémentaire, tout pour adoucir les derniers jours, et qu'on assiste impuissant au saccage de son travail par un type sans diplôme qui s'est formé en un week-end sur Internet. C'est pas des manières de faire croire aux mourants que c'est de leur faute s'ils ne verront pas leurs gosses grandir, ni ne pourront serrer leurs petits-enfants dans leurs bras: « Josette, fallait pas la manger, cette grosse orange bien juteuse et bien sucrée. Maintenant, faut passer à la caisse ! »
Je lui aurais bien dit deux mots, au naturopathe, mais il n'est jamais venu la visiter à domicile, Josette. Pour pas renifler l'odeur de la merde qu'il a étalée sur les murs, sûrement. J'imagine que même lui avait un minimum d'exigence morale : il ne lui aurait pas menti de cette manière s'il avait vu les draps blancs sur les miroirs de la salle de bains et, en train de mijoter sur la cuisinière, la cassolette d'eau aromatisée à l'eau.
Mais bon, ça lui a donné de l'espoir, à Josette (et à lui, 90 euros).
Moi, je prenais mon mal en patience. »
« Pourtant, ce qui constitue le cœur de notre métier reste l'angle mort de nos facultés : on ne nous apprend pas à écouter. Quel constat décourageant ! »
« La morale étant: les patients ne sont pas des livres, les soignants ne sont pas des lecteurs, ce sont tous des humains qui essaient de chercher un chat noir dans une pièce obscure en parlant des langues différentes. Mais vous savez quoi ? Ils ont tous une trouille bleue de la mort. »
« Après, c'est vrai qu'on est plus délicat avec une femme battue qu'avec un homme qui bat. Même si ça ne répare rien du tout. Pas les nez, en tout cas.
Au moment de partir, la main sur la poignée de porte, elle se tourne vers moi et me tend son télé-phone: sur l'écran, c'est elle, avec dix ans de moins et un vrai nez, celui d'origine, je veux dire.
- J'étais belle, docteur? Hein que j'étais belle, avant?
J'ai envie de pleurer d'un coup. Parce que c'est vrai. Elle était très belle.
Et son mari, à Mme Gonzales?
Il va bien, je crois. Faut dire qu'il est bâtonnier dans une grande ville. Le bâtonnier, c'est un peu comme le président des avocats. Sauf qu'il est élu par eux, avec qui il va boire des coups à la buvette du palais. Vous vous rendez compte ? C'est moins facile de couper le nez de sa femme et de s'en sortir quand t'es prolo...
J'ai cru que les larmes allaient enfin sortir avec cette histoire, mais non. Pleurer est un moyen pour le corps de témoigner de notre sens de la justice, et je ne suis pas moins sensible à l'injustice que n'importe qui. »
« Ce jour-là, Virginie m'aura démontré que, peut-être (je ne le saurai jamais avec certitude), rien n'est gratuit avec les hommes quand on est femme. Rien.
Quel chemin parcouru avec Virginie ! Il a fallu qu'on s'apprivoise. Qu'elle m'accorde sa confiance. Une astuce qui réussit à chaque coup, j'ai remarqué, c'est, je cherche le terme qui convient, de res-pecter les gens. Voilà! Fou comme ça fonctionne de ne pas les considérer tel un bout de viande qu'on palpe, soupèse, ausculte, mais de vraiment les voir, je cherche le terme qui convient là encore, comme des êtres humains ? Suffisait d'y penser ! Avec Virginie, ce qui a consolidé son sentiment de sécurité, c'est quand je lui ai demandé: « Vous voulez bien que je vous examine ? », alors qu'elle venait juste pour une angine. Elle a dû se dire: « S'il me demande ça pour regarder dans ma gorge, il me le demandera pour le reste. »
Elle n'avait pas tort. Je demande tout le temps, pour tout, et pas seulement pour le reste.
C'est dingue, mais, dans notre société, des médecins s'inquiètent que les patientes se plaignent de ne pas avoir consenti à l'examen. Un confrère s'est exprimé l'autre soir, en réunion pluridisciplinaire : « J'ai peur qu'on nous accuse de viol parce qu'on pratique certains examens. » Il fronçait les sourcils et enfilait ses perles, l'air un peu ahuri et choqué, même qu'il a claironné :
- Si tu vas chez ton gynécologue, tu sais bien que c'est pas pour faire un bridge !
J'ai repensé à toutes mes patientes... Ce qu'il veut dire, le confrère, c'est qu'une fois dans mon cabinet de médecin leur corps ne leur appartiendrait plus et que je serais subitement dépositaire d'un « consentement tacite et illimité ». Hey, Virginie! Vous entendez ? Je ne savais pas que ça existait, un pouvoir comme ça! Ça paraît même un peu dangereux. Quelle pensée fanée! Elle sent fort le « si tu montes chez un garçon après un restau, tu sais bien que c'est pas pour jouer au tennis » et autres bizarreries d'arrière-garde.
D'ailleurs, il commence où, ce consentement illimité ? Je peux aller tâter les couilles de M. Lopez en salle d'attente? Ou je dois attendre que la porte du bureau se referme sur Mme Laurent pour sauter sur ses seins ?
Il existe des tas de métiers où tu n'as même pas besoin de parler aux gens si tu ne les aimes pas. Nous, on choisit celui où on doit leur parler ET en plus les toucher. Oui, nous, soignants, on touche les gens, parfois même on touche leur sexe.
Du coup ?
C'est bien d'expliquer pourquoi et de demander l'autorisation avant.
C'est bien d'expliquer pourquoi et de demander l'autorisation pendant.
En fait, plus que bien, c'est normal.
C'est même plus que normal : obligatoire.
Et ce qui est encore plus obligatoire, c'est d'arrêter d'examiner le sexe des gens si les gens vous demandent d'arrêter. Même s'ils ont dit oui deux secondes plus tôt. Le consentement tacite et illimité n'existe pas. »
« Cette maladie est très peu étudiée : elle touche surtout les femmes, et on s'en fiche un peu beaucoup passionnément de la santé des femmes, alors qu'un mec qui n'arrive pas à bander représente une tragédie internationale. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une manière, pour une société où la culture du viol est omniprésente, d'oblitérer les consé-quences que peuvent avoir les violences sexuelles sur les victimes, et la manière dont ces violences si communes pourraient générer une maladie réelle.
Dans l'oreille de Mme Chahid, si bavarde Mme Chahid, il y a un cabinet médical où l'on peut parler et être écouté. Même pleurer à l'envi. Eh bien, savez-vous ce qu'il y a dans le vagin des femmes ? Sûrement pas un temple, où toutes ces conneries de féminin sacré les enferment dans des fables mythologisantes à la con, non. Pas de temple.
Mais je suis sûr qu'il y a dans le vagin des femmes un cabinet médical où mille hommes consultent. Des hommes fainéants, des hommes égoïstes, des hommes toxiques, des hommes beaucoup trop sûrs d'eux, des hommes qui ne pensent qu'à eux. Me relancez pas sur le sujet ! »
« Un homme qui doit, sa vie durant, remettre à un tiers le fruit de son travail et faire prospérer à la sueur de son front le tour de taille d'un patron développe à l'égard de la maladie une forme de fatalité effrayante. L'exploitation l'a rendu docile, même à l'égard de sa propre mort. »
« Parfois, une personne souffle: « Ça fait partie des choses qu'on dit qu'on fera et qu'on ne fait pas, c'est con. »
Oui, c'est con. Sans doute qu'on ne devrait jamais remettre à plus tard, parce qu'il est toujours plus tard qu'on ne le pense dans la vie. »
« Je n'ai peut-être pas baisé, mais c'était sans doute les 20 balles les mieux investies de ma vie, parce qu'un grand calme se fait à l'intérieur de moi. Vous voyez, quand le ruisseau reprend sa forme après une crue? Voilà. Même que je pense souvent à cet homme, à sa gentillesse. Je voudrais le rassurer, je n'étais pas un mec bizarre, j'étais juste comme un enfant mort qu'il a fait reve-nir chez lui, à sa manière, bien moelleuse et bien tendre. Et gratuite, en plus. C'est pas fréquent, les choses gratuites dans la vie. Y a rien de plus précieux, même. Ça peut réconcilier des coins cassés en vous qui se tirent la gueule depuis longtemps. »
« Que les enfants meurent est la preuve irréfutable que, oui, ici-bas, rien ne ment. Évidemment, cette épiphanie personnelle ne dit rien ni du grand mystère de l'existence, ni de la question du bien ou du mal, mais elle me signifie dans son langage secret, et c'est prodigieux, que les choses sont ce qu'elles sont, et que si elles n'étaient pas ainsi, alors ce promeneur en contemplation devant le fleuve ne serait pas exactement ce promeneur, et je ne serais plus exactement non plus ce médecin qui pense, et pourrait pleurer en pensant à la mort de deux enfants. Oh, Alvaro, tu as bien raison, le monde ne ment pas. Et l'expérience des ans aidant, est-ce que j'y parviendrai un jour, à cette prouesse-là, moi : l'aimer, ce monde, et l'aimer sans rien attendre en retour, c'est-à-dire l'aimer pour rien ?
J'ai encore tellement de questions en moi, et si peu de réponses. Où est-elle, la vie, hein ? Où ? Est-ce que je passe à côté de la mienne ? Pourquoi fait-on mal à nos mères en venant ? Pourquoi se fait-on tant de mal tout le temps ? Et où est passée notre enfance ? Et les cafés au lait de nos grands-mères ? Qu'est-ce que c'est, l'Univers ? Et quelle est ma place dedans ? Qui mangera les vers qui nous mangeront ? Pourquoi c'est dur, un clou en fer ? Et pourquoi j'ai marché dessus? Pourquoi ça existe, la mélancolie ? Qu'est-ce qu'on pleure ? Et qui nous pleure ? Est-ce qu'on peut ramasser les larmes des autres pour les coller sur nos joues ? Pourquoi je ne me souviens pas de toute mon existence ? Dans quel trou sont tombées toutes mes plus belles années ? Où vont les larmes quand elles sèchent ? Pourquoi j'ai peur ? Où vont nos amours quand elles meurent? Et qu'est-ce que c'est, l'exil? Pourquoi je me sens seul, même à plusieurs? Est-ce que quelqu'un veut bien être mon frère? Ma sœur ? Est-ce qu'il y aura des bateaux pour moi ? Pour nous ? Un port paisible? Où accoster enfin ? Et un joli matin? Est-ce que tu me prêteras ta main? Aura-t-on connu le bonheur ? Est-ce qu'on n'aura plus peur, là-bas ? Plus jamais ? Est-ce que je me pose vraiment ces questions ? Quelle est ma place dans ce grand paysage ? Et pourquoi je veux toujours, toujours, demander pardon? Est-ce que quelqu'un écoutera ou lira ça ? Est-ce que quelqu'un écoute ou lit ça maintenant ? Est-ce que c'est seulement écrit ? L'ai-je vraiment dit à voix haute ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
Pardon d'avoir dit tout ça.
On va enfin pouvoir pleurer, maintenant. »
Quatrième de couverture
Jean a trente-six ans. Il fume trop, mâche des chewing-gums à la menthe et fait ses visites de médecin de famille à vélo. Il a supprimé son numéro de portable sur ses ordonnances. Son cabinet médical n'a plus de site Internet. Il a trop de patients: jusqu'au soir, ils débordent de la salle d'attente, dans le couloir, sur le patio.
Tous les jours, Jean entend des histoires. Parfois il les lit directement sur le corps des malades. Il lui arrive de se mettre en colère. Mais il ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge. Il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué six minutes.
Médecin généraliste dans le Sud-Ouest, Baptiste Beaulieu est l'auteur d'un récit Alors voilà. Les 1001 vies des Urgences (Fayard), traduit en quatorze langues, et de plusieurs romans qui sont autant de succès en librairie.
Éditions de l'Iconoclaste, octobre 2023
272 pages