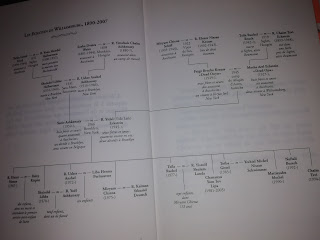Parler des livres. Commandés. Aimés. Partagés. Sauvés. Donnés. Glanés. Cultes. Des livres qui sauvent la vie. Parce que "Lire est un remède fantastique, magique [...]". C'est ce que nous propose, entre autres, Alba Donati dans ce bel hommage aux livres, aux librairies indépendantes - ces puissants connecteurs -, mais aussi à la nature, à la solidarité, l'amitié.
Qu'il fut bon, ces derniers jours, d'arpenter cette librairie Sopra la Penna et contempler le jardin enchanté et les montagnes apuanes qui l'entourent, de découvrir cette belle communauté qui gravite autour, ces aimants des mots, des pages. Il est des lectures où il fait bon s'abandonner, se déconnecter du présent, celle-ci s'y prête très bien à mon humble avis. Elle pourrait même avoir le pouvoir de redonner vie à de vieux rêves plus ou moins enfouis, qui sait ?
« [...] les choses seraient peut-être différentes sans le jardin, Lucignana, le mont Prato Fiorito, le silence. Je mène sans doute une expérience extrême de libraire, une situation idyllique et radicale qui vit dans et du lieu, de son caractère impensable. Une librairie pour cent quatre-vingts habitants, destinée sur le papier à l'échec commercial, qui, en avançant à contre-courant, intercepte ses semblables dans la tourmente et les conduit chez elle. Il n'y a pas tout dans ce cottage, mais de nombreuses choses nécessaires. Voilà pourquoi je me lève à sept heures et ouvre, arrose, range les livres sur les étagères, surveille la pousse des pivoines tout en sachant que personne ne viendra dans cette zone rouge. J'agis comme si, parce que les dépêches ministérielles ne peuvent mettre fin à une expérience radicale, idyllique. La passion ne tient pas compte des lignes d'arrivée, elle se meut, alimentée par son propre mouvement inté rieur. Pourquoi as-tu ouvert une librairie dans un village inconnu ? Parce que j'avais besoin de respirer, parce que j'étais une fillette malheureuse, parce que j'étais une fillette curieuse, par amour pour mon père, parce que le monde va à vau-l'eau, parce qu'il ne faut pas trahir les lecteurs, parce qu'il faut éduquer les plus jeunes, parce que, à l'âge de quatorze ans, je pleurais toute seule devant la télé à l'annonce de la mort de Pier Paolo Pasolini, parce que j'ai eu des institutrices et des professeurs extraordinaires, parce que je me suis sauvée. »
Une passionnée de livres, déterminée coûte que coûte à maintenir sa librairie et qui nous parle de sa passion, mais pas que, que demander de mieux ! Merci infiniment Karine pour avoir mis ce livre sur ma route. Une belle parenthèse. J'irais bien y faire un tour aussi dans cette librairie !
Ma wishlist livresque s'est enrichie, au passage, de quelques références 😅
« J'aime les livres qui vous poussent à lire d'autres livres. Une chaîne que nous ne devrions jamais interrompre. La seule forme d'éternité que nous puissions expérimenter ici sur terre, disait Pia. Le jardin est une forme d'éternité. »
« Romano, j'aimerais ouvrir une librairie là où je vis.
- Bien, combien d'habitants y a-t-il?
- 180.
- Bon, 180 000 divisé par...
- Pas 180 000, 180.
Tu es folle. »
Conversation téléphonique avec Romano Montroni, ancien directeur des librairies Feltrinelli.
« Il était une fois une maison de poupée qui appartenait à une reine... une maison de poupée si joliment fabriquée qu'on venait parfois de loin pour l'admirer. »
Vita Sackville-West, Les Secrets et enchantements de la maison de poupée de la reine d'Angleterre
« L'idée de la librairie était certainement tapie dans les replis de ce lieu sombre et joyeux qu'on nomme l'enfance.»
« Je termine les paquets pour la dame de Salerne et ses deux filles. Voilà comment m'est venue l'idée d'ouvrir une librairie dans un petit village de la haute Toscane, au sommet d'une colline, entre le mont Prato Fiorito et les Alpes apuanes. Cette idée m'est venue pour qu'une mère de Salerne puisse offrir à ses filles deux cartons pleins en hommage à Emily Dickinson. »
« Papa n'est pas étranger à la librairie. C'est lui qui m'a appris à écrire, à l'âge de cinq ans, si bien qu'un an plus tard j'étais capable de rédiger de petites lettres à l'intention de tante Feny, alors gouvernante à Gênes. Né, comme nous tous, dans une famille pauvre, papa était l'aîné de six enfants: Rolando, Valerio, Aldo, Maria Grazia, Valeria et Rina. Chacun plus excentrique que l'autre.
Il a vu le jour en 1931. Pendant la guerre, il s'était engagé dans la Résistance comme un adulte, écoutait Radio Londres et se déclarait antifasciste. Au village, tout le monde était antifasciste. En cela, Lucignana est exceptionnel. Pas de déférence pour les puissants : tous ceux qui se présentent en bombant le torse dans un rôle quelconque finissent par se ridiculiser comme les doctes docteurs de Pinocchio. On prétend que, sous le fascisme, Lucignana était la seule agglomération d'Italie à ne compter aucun encarté. Venus de la ville, des individus déguisés en petits chefs de parti se présentaient au village et n'y trouvaient personne. Les habitants se cachaient dans les champs, dans les cabanes, dans les séchoirs, et adieu carte. »
« La jeunesse dotée d'intelligence me séduit. Mais, c'est vrai, [...] , nous avons « nos livres », qui ne sont pas ceux qu'on trouve partout. La librairie est comme une bibliothèque personnelle ; les livres, qu'ils soient récents ou non, doivent avoir un sens, celui d'avoir été choisis pour trôner sur tel ou tel rayonnage. Des choix arbitraires ? Peut-être. Comme la décision de séparer les romancières des romanciers. Je l'ai prise d'instinct. Puis, en réfléchissant, je me suis dit : les femmes qui écrivent sont un phénomène du siècle dernier. Et puisqu'elles écrivent après avoir gardé le silence pendant des siècles, elles ont certainement un tas de choses à raconter et elles les racontent probablement d'autres façons. Alors n'est-il pas logique qu'elles aient deux ou trois étagères pour elles toutes seules ? »
« « Tu as l'air triste, de quoi as-tu besoin pour être plus heureuse ? »
Je souris.
« Eh bien, en ce moment, de dix mille euros.
- Bon, tu les auras cet après-midi.
- ... »
Elle m'embrasse et des larmes montent à ses yeux bleus.
« C'est l'héritage de ma mère. Elle l'aurait voulu. Elle nous a appris à aider ceux qui sont dans le besoin. Elle s'y est employée toute sa vie. »
Tessa nous a offert un marque-page qui est devenu notre signet officiel. On peut y lire ces mots : « Ma maman, Jean Martin, m'a appris à prendre soin des autres. Mon père, Grenville, a recueilli des malheureux le long de la route et leur a offert des opportunités. Son propre père le lui avait enseigné malgré l'extrême pauvreté dans laquelle il avait grandi. »
Ces quelques lignes sont signées de la mère de Tessa, Lynn Holden Wiechmann. Oui, Holden, elle s'appelle Lynn Holden¹.
Commandes du jour: Hopper de Mark Strand, Les femmes qui achètent des fleurs de Vanessa Montfort, Cuore cavo de Viola Di Grado, Le Garçon sauvage de Paolo Cognetti. »
1. Allusion à la Scuola Holden, école d'écriture fondée en 1994 par Alessandro Baricco, elle-même baptisée de la sorte en hommage au personnage de J. D. Salinger, Holden Caufield.
« Dans le très beau livre de Rabih Alameddine intitulé Les Vies de papier, une femme, qui vit à Beyrouth, esseulée et sans but, traduit tous les livres qu'elle aime. Son appartement est rempli de feuilles de papier, de livres traduits par amour et éparpillés dans toutes les pièces. Dans celui de l'étage supérieur se retrouvent tous les après-midi trois amies qui discutent, se maquillent, racontent la vie du dehors. Un chœur scénique pour sa solitude. Eh bien, je me représentais ces femmes ainsi, comme Iole, Redenta et Mery, et leurs voix comme une musique tantôt douce, tantôt frénétique et nécessaire. Voilà, Les Vies de papier est l'un des romans que je continuerai de conseiller, même s'il est sorti il y a une dizaine d'années.
Commandes du jour : Trop de bonheur d'Alice Munro, Il romanzo di Moscardino d'Enrico Pea, Le Bruit des choses qui commencent d'Evita Greco, Nehmt mich bitte mit de Katharina von Arx, Jane Austen de Virginia Woolf, Le cose semplici de Luca Doninelli. »
« Lucignana n'est pas peuplé de reines, mais de nombreuses fées. De toute façon, pour le rallier, comme dit mon amie Anna D'Elia, il faut traverser la forêt de Brocéliande. Certes, c'est une promenade de santé, pour elle qui a l'habitude de traduire les denses forêts de mots d'Antoine Volodine.
Derrière la forêt habitent les fées : la librairie leur appartient. "Crowd". »
« Il y a un rayon de la librairie que j'aime tout particulièrement. Celui des biographies. Disons qu'entre Proust et Sainte-Beuve, j'ai toujours penché pour Sainte-Beuve. Les écrivains ne font pas d'exercices de mathématiques, ils puisent dans les nœuds et les obsessions, dans les zones d'inexistence. »
« À New York, j'avais déniché un exemplaire de "La Cloche de détresse" de Sylvia Plath chez les bouquinistes qui sont installés autour de Central Park. Le seul roman qu'elle ait écrit, signé d'un pseudonyme, Victoria Lucas. Je l'avais placé dans la librairie à côté de deux autres livres achetés au même endroit, ils formaient un brelan d'as qui me paraissait très protecteur. "La Cloche de détresse" trônait auprès de "L'Année de la pensée magique" de Joan Didion et de "La Porte" de Magda Szabó*, dans une traduction d'Ali Smith. Avoir trouvé mes trois livres cultes au même endroit m'avait évoqué l'inéluctable parcours d'amour qui est inscrit dans nos vies. Puis tout a brûlé et cela m'a beaucoup chagrinée. Mais nous avions en tête la canne de Virginia. Verticale, malgré la pluie battante et le vent. »
« Le petit monde qui tourne autour de la poésie croit que tout se résume à l'algébrique Valerio Magrelli ou à l'ésotérique Milo De Angelis, alors qu'il existe aussi le tragique Roberto Carifi. En tant que libraire, j'essaie de corriger les déformations des petits potentats éditoriaux en aménageant des rayons alternatifs, des vitrines subversives. De petits gestes, certes, mais durables.
Les choses n'oublient pas, elles ont trop de mémoire. »
1. Roberto Carifi, "Amorosa sempre", La Nave di Teseo, 2018. Notre traduction.
« Le thé est une étape fondamentale de la visite de la librairie. Chaud en hiver et froid en été. L'hiver, nous utilisons un thé produit en Espagne qui se décline en d'innombrables parfums. On part de la base : the vert, noir, rouge, blanc. Puis on choisit entre vanille, bergamote, ginseng, mangue, lime, curcuma, gingembre, cannelle, mandarine, miel et citron.
L'emballage de ce thé a une allure mexicaine, du fait de ses couleurs vives et bien agencées. Nous l'avons baptisé le thé de Frida Kahlo. Le thé qui vient du Kent se présente tout autrement. English tea in English box. Ce sont des boîtes de collection ornées du portrait d'un écrivain ou d'une écrivaine. À chaque auteur ou livre, un thé particulier
: Jane Austen, thé vert chinois aux pétales de rose; Charlotte Brontë, thé vert chinois aux fleurs de jasmin ; Alice au pays des merveilles, fraise et mélange de fruits : morceaux de pomme, hibiscus, baies de sureau, églantier et ananas. Le mélange de Mary Shelley, très particulier, contient du thé noir et des violettes; celui des Quatre Filles du Docteur March s'inspire du gâteau Red Velvet : thé noir, chocolat et vanille. »
« Naturellement, là où il y a un excellent thé, il y a forcément de bonnes confitures, et dans ce domaine nous nous sommes surpassées. À l'origine de ces merveilles, une femme fascinante qui semble tout droit sortie d'un film de Bernardo Bertolucci. Elle s'appelle Anna et elle est violoncelliste. Une violoncelliste qui joue dans l'orchestre du Maggio Musicale Fiorentino depuis 1983. Anna aime cuisiner. Elle utilise deux patronymes différents, l'un pour la musique, l'autre pour la gastronomie. Ses yeux gris trahissent une beauté au long cours. J'ignore ce qu'elle a entre les mains, quel enchantement les guide dans ses réalisations. Elle a donné un nom à sa passion : Une nouvelle musique à la cuisine.
Elle incarne bien la définition de Colette selon laquelle la cuisine, la vraie cuisine, est l'œuvre de femmes qui goûtent, rêvent un moment, ajoutent un filet d'huile, une pincée de sel, une branchette de thym, pèsent sans balance, mesurent le temps sans horloge, surveillent leur rôti avec les yeux de l'âme et mélangent les œufs, le beurre et la farine au gré de leur inspiration, telles de bienveillantes sorcières.
Ensemble nous avons inventé les confitures littéraires. J'ai étudié, cherché, humé les goûts des écrivains et des écrivaines, ou de leurs personnages, et Anna y a ajouté sa fantaisie. Elle a produit la confiture Virginia Woolf avec des oranges amères et du whisky ; celle de Jane Austen avec des pommes, du citron vert et de la cannelle ; celle de Colette avec des prunes sauvages et de l'anis étoilé; celle de Dino Campana et Sibilla Aleramo avec des poires sauvages cueillies sur un arbre séculaire de la villa de Bivigliano, non loin de Marradi, le bourg natal de Dino Campana, et cuites dans du vin rouge épicé. De petits chefs-d'œuvre dont nos visiteuses raffolent. On a demandé plusieurs fois à Anna d'exporter ses confitures littéraires, mais elle a toujours refusé, nous sommes d'accord : on ne les trouve que chez nous. »
« L'après-midi s'est conclu par un bon thé à la rose, des biscuits en forme de cœur confectionnés par Donatella et des beignets de Tiziana. La pandémie nous offre - et ce n'est certes pas dans son programme - de nouvelles habitudes. Elle nous offre le temps du dimanche, un temps sans devoirs ni tâches. Un temps consacré. »
« J'aime les livres qui vous poussent à lire d'autres livres. Une chaîne que nous ne devrions jamais interrompre. La seule forme d'éternité que nous puissions expérimenter ici sur terre, disait Pia. Le jardin est une forme d'éternité. »
« Hier soir, en jetant un coup d'œil dans le réfrigérateur et en y remarquant un excès d'œufs et de beurre, je me suis lancée dans la confection d'un gâteau Margherita sans balance. J'ai dit : si Colette y parvenait, je peux y parvenir moi aussi. Trois œufs, un peu de sucre, un peu de farine, un sachet de levure, un peu de lait chaud et un peu de beurre fondu. Et voilà. Trente minutes au four, et un résultat merveilleux. J'étais heureuse d'avoir su mesurer ce « peu ». Le peu « de ceux qui pèsent sans balance » est ce qui affole les critiques, les philologues, parce qu'il s'agit d'une pure invention, d'une syllabation innée qu'il est impossible d'enseigner, de cataloguer, de régler. Un filet d'huile à discrétion est une défaite académique. Alors vivent les George Steiner, les Cesare Garboli, les Colette et les Virginia Woolf, les Elsa Morante, tous ceux et celles qui savaient qu'on fait de la littérature avec un filet d'huile. »
« Robert Frost disait : « Un poème commence comme une boule dans la gorge, un sentiment du mal, une nostalgie, un mal d'amour¹. » »
1. Robert Frost, The Letters of Robert Frost to Louis Untermeyer, Holt, Rinehart and Winston, 1963. Notre traduction.
« Je t'embellis tout doucement, mon jardin, en attendant que quelqu'un s'asseye, hume, bondisse, feuillette, sirote, demande, plisse les paupières, heureux. »
« Les hirondelles parlent comme nous, mais chez elles la note de la perpétuelle jeunesse semble innée. »
« [...] les choses seraient peut-être différentes sans le jardin, Lucignana, le mont Prato Fiorito, le silence. Je mène sans doute une expérience extrême de libraire, une situation idyllique et radicale qui vit dans et du lieu, de son caractère impensable. Une librairie pour cent quatre-vingts habitants, destinée sur le papier à l'échec commercial, qui, en avançant à contre-courant, intercepte ses semblables dans la tourmente et les conduit chez elle. Il n'y a pas tout dans ce cottage, mais de nombreuses choses nécessaires. Voilà pourquoi je me lève à sept heures et ouvre, arrose, range les livres sur les étagères, surveille la pousse des pivoines tout en sachant que personne ne viendra dans cette zone rouge. J'agis comme si, parce que les dépêches ministérielles ne peuvent mettre fin à une expérience radicale, idyllique. La passion ne tient pas compte des lignes d'arrivée, elle se meut, alimentée par son propre mouvement inté rieur. Pourquoi as-tu ouvert une librairie dans un village inconnu ? Parce que j'avais besoin de respirer, parce que j'étais une fillette malheureuse, parce que j'étais une fillette curieuse, par amour pour mon père, parce que le monde va à vau-l'eau, parce qu'il ne faut pas trahir les lecteurs, parce qu'il faut éduquer les plus jeunes, parce que, à l'âge de quatorze ans, je pleurais toute seule devant la télé à l'annonce de la mort de Pier Paolo Pasolini, parce que j'ai eu des institutrices et des professeurs extraordinaires, parce que je me suis sauvée. »
« Avoir un bon emploi, avoir quarante ans, et savoir que ça ne suffit pas. Que faire ? Attendre la retraite pour se consacrer enfin à ses propres passions ? La retraite arrive quand la santé s'en va. Nous avons attendu trop longtemps pour être ce que nous désirons. Alexandre Soljenitsyne ne dit-il pas, dans ce terrible livre qu'est "Le Pavillon des cancéreux", qu'à force de ne plus être soi-même, « les cellules de notre cœur que la nature a créées pour la joie, inutiles, dégénèrent¹ ». »
1. Alexandre Soljenitsyne, Le Pavillon des cancéreux, traduction de M. et A. Aucouturier, L. et G. Nivat, J.-P. Sémon, Éditions Julliard, 1968.
« La librairie est une école, une fenêtre sur un
monde que nous pensons connaître et qui n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'il faut lire pour connaître vraiment le monde parce que les gens qui écrivent partent toujours d'un détail qui cloche. Et quand « le compte des dés n'est pas bon », comme dirait Montale, il ne reste plus aux auteurs et autrices qu'à accueillir la contradiction, à s'aventurer dans les rues obscures du moi, à être l'obscurité même, il n'y a pas d'autre solution. Je pense au début de "La Storia" d'Elsa Morante, quand Gunther, le jeune soldat allemand au regard désespéré, viole Iduzza, institutrice dans le quartier de San Lorenzo, à Rome. Une violence est une violence, néanmoins Elsa Morante n'est pas une juge. Elsa se glisse dans ce regard désespéré, dans cette « horrible et solitaire mélancolie » et y voit reflété le regard d'Iduzza, y trouve l'enfance, accrochée à eux telle une infirmité. Elle y trouve ce qui les unit, non ce qui les sépare. Il faut s'habituer à ce regard de l'arrière, du bas, du haut, de loin, de près que les écrivains mettent en scène. Les certitudes, les mots d'ordre se perdent, mais il arrive parfois, comme ce fut le cas pour Alberto Manguel, que nous soyons émus. En relisant le début de l'histoire, en entrant chez Iduzza à l'instant où se consume cet acte de violence ou d'amour, on aurait envie de dire : pardonnez-nous cette intrusion... »
« « Maman, je veux redevenir petite et vivre toujours avec toi. »
Voilà ce qu'elle m'a dit, en larmes. Il n'y a pas de psychanalyse qui tienne quand votre fille vous lance cette phrase : vous lâchez tout et allez la rejoindre.
J'ai préparé des boulettes à la sauce tomate, des blancs de poulet au lait, de la purée de pommes de terre, j'ai recréé la cellule primordiale. En réalité, Laura est juste effrayée par cette maudite école, par l'examen de fin d'études secondaires, par l'obligation de grandir. »
« Il n'est pas nécessaire de comprendre à fond la vie, mais il est indispensable de rencontrer la tendresse. Elle vous pénètre et vous traverse, vous fait vous mouvoir, vous guide. Comme dans le jeu du Mikado, un individu en sauve un autre. Un par un. Un par un. Et nous ne nous retournons pas sur les personnes que nous avons sauvées, car, c'est bien connu, cela porte malheur. Nous regardons toujours vers l'avant, vers la prochaine. »
« Annie Ernaux est mon modèle. Je conçois la littérature comme de la non-fiction ; une histoire inventée ne me passionne pas, ne m'enrichit pas. D'une certaine façon, Ernaux a partagé sa vie en plusieurs pièces, elle a placé dans l'une son enfance, dans une autre sa mère, dans une autre encore sa sœur emportée par la diphtérie avant sa naissance, et à chaque événement correspond un livre. Si je le voulais, je pourrais moi aussi écrire pendant vingt ans. J'ai une pièce pour la violence sexuelle, une deuxième pour une grave maladie, une troisième pour une fille soumise à sa naissance à la pose d'un switch artériel, une quatrième pour ma mère, une cinquième pour mon père; bref, il y a de quoi fouiller toute la vie.
Ce sont des actions qui requièrent de l'attention, nous obligent à formuler le délictuel et en même temps à voir surgir le merveilleux à ses côtés. Il faut en faire grand cas. Le merveilleux est moins éclatant, il importe de le chercher, de l'attendre, de le débusquer, mais quand il se produit il nous domine. »
« J'aimerais avoir plus de fleurs, plus de Primula auricula, plus de Primula pulverulenta, plus de Rosa gallica, plus de Dianthus gratianopolitanus, plus d'Ortensia macrophylla, plus de Plumbago capensis, plus de Paeonia officinalis, plus de Lavandula angustifolia. Mon rosier grimpant est malade, il souffre, il perd ses feuilles, qui jaunissent de plus en plus. Manque-t-il d'azote ? Reçoit-il trop de phosphore ? Trop d'eau ? Trop de soleil ? Le pot est-il trop petit ? Les fleurs et les êtres souffrent pour de nombreuses raisons, et il est très difficile d'y remédier. »
« Voilà ce que je répondrai à tous ceux qui me demandent comment l'idée d'ouvrir une librairie dans un endroit perdu m'est venue à l'esprit. L'endroit ne sait pas qu'il est perdu et, que je sache, Puerto Viejo de Talamanca est peut-être un endroit perdu. Le fait est que, pour moi, cet endroit perdu est le centre du monde parce que je le regarde avec les yeux d'une fillette qui a gravi des marches branlantes et vécu dans des maisons glaciales, par des hivers glaciaux ; une fillette qui a réparé les choses cassées avec les moyens dont elle disposait. Réparé un poème de Seamus Heaney me revient à l'esprit, « La réparation de la poésie ». « Oui, Madame, j'ai ouvert une librairie ici, dans un lieu perdu qui ne sait pas qu'il est perdu, parce que je devais réparer des marches, des radiateurs, des salles de bains. Je les ai arrangés ainsi, avec les livres que j'ai le plus aimés. »
Maintenant que j'ai terminé mes réparations, j'ai tout loisir de me consacrer à celles des maisons d'autrui.
Et pour ne pas succomber à cette longue période de travail, aggravée par les maladies, les incendies et les pandémies, il serait peut-être utile d'établir une liste des choses qui me mettent en joie. Les listes sauvent la vie, alimentent la petite flamme de notre mémoire, comme le disait Umberto Eco à propos du « vertige de la liste ».
Je commence donc :
- le message vocal de Laura qui m'apprend qu'elle participe à la manifestation transféministe comme s'il s'agissait d'un événement aussi banal qu'aller faire ses courses au supermarché et qui me prie de ne pas répondre à son fiancé qui naturellement la cherche, ne la trouve pas, s'énerve et, de surcroît, « ne connaît même pas la différence entre un gay et un hétéro » ;
- les messages vocaux de Raffaella qui me décrit, de Milan, la joie de recevoir nos paquets ;
- la démarche de Maicol qui parcourt à grandes enjambées les rues pavées du village en menant sa vie à toute allure ;
- la décision de ma nièce Rebecca d'intégrer le groupe de bénévoles de la libre que sa misanthropie accouchera d'un phénomène inattendu;
- l'existence de mon père ;
- le café que je vais bientôt prendre avec Tessa qui vient de Lucques à moto le matin pour m'apporter les marque-pages de la librairie qu'elle nous offre depuis toujours et où figure sur un côté une citation de sa mère, Lynn ;
- le jour où, lors du colloque de Lucques, Emanuele Trevi et le photographe Giovanni Giovannetti ont été surpris par un vigile, piazza San Michele, en train de fumer un pétard dans une voiture. Mais ce vigile n'était autre que l'écrivain Vincenzo Pardini et tout s'est terminé par des bourrades amicales;
- Ernesto et maman enlacés sur le canapé;
- [...]. »
Quatrième de couverture
« La vérité, c’est qu’il faut lire pour connaître vraiment le monde parce que les gens qui écrivent partent toujours d’un détail qui cloche. »
Alba Donati menait une vie trépidante. Pourtant, à la cinquantaine, elle décide de tout quitter pour réaliser son rêve : ouvrir une librairie en Toscane, dans le village de son enfance. L’aventure semble rapidement vouée à l’échec. Perchée sur une colline, avec moins de deux cents habitants dans les environs, la librairie doit affronter un incendie destructeur, puis les restrictions du confinement. Mais alors que tout paraît perdu, il s’organise autour d’Alba un étonnant et formidable mouvement de solidarité.
Ce récit inspirant et plein d’humanité est celui d’une femme passionnée qui rêvait de changer de vie.
« J’ai savouré ce manifeste érudit et charmant. Une ode aux librairies indépendantes et aux doux dingues qui se battent chaque jour pour les faire exister. »
Libération
« Cette librairie est une petite forteresse de résistance féministe et poétique qui a fini par prendre la forme d’un livre. Une épopée hors du commun. »
Le Monde des livres
Éditions Christian Bourgois, mars 2024
304 pages
Traduit de l'italien par Nathalie Bauer