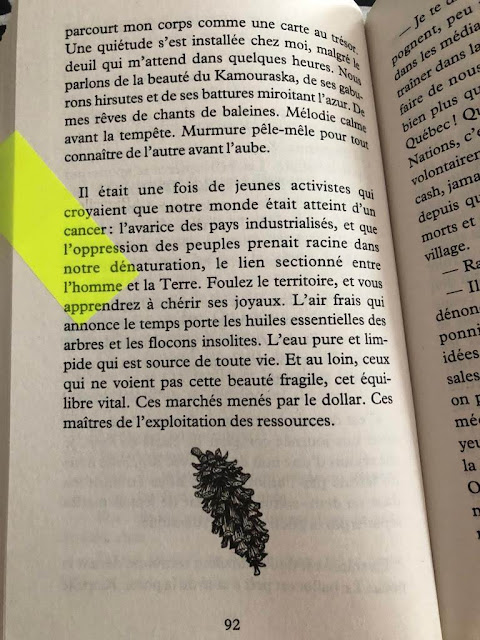« C'est un livre pour parler la nuit, en silence, avec les mots des morts trop vite partis. »
Jean-Claude Grumberg crie sa douleur et son amour pour sa bien-aimée Jacqueline, partie le 04 mai 2019 à l'âge de 82 ans. Et ce cri est à la fois beau, tendre et déchirant. 60 ans de vie partagée, à s'aimer, vivre côté à côté, peau à peau, à s'éloigner aussi parfois. Une histoire d'amour qui prend merveilleusement vie sous la plume de l'auteur, une plume poétique, fluide, délicate.
Il écrit pour lui, pour la garder auprès d'elle le plus longtemps possible, pour ne pas qu'elle lui échappe, pour la respirer, la toucher encore et encore, la faire vibrer et rire encore une fois, une dernière fois, « pour garder la douceur et la douleur de [l]'avoir en [lui] ».
Il écrit pour elle, une promesse de tenter de réparer, de l'aimer aussi du bout de sa plume.
Du bout des lèvres en songe.
Quand il ne reste plus que les songes.
L'absence crève le cœur.
La colère s'immisce.
L'incapacité à trouver les mots justes, les mots tout court.
À déposer le point final.
La sincérité, la spontanéité, l'urgence de ce témoignage, presque obligatoire, l'autodérision aussi, la lucidité et l'humour toujours et encore... sont les mots qui me viennent spontanément en refermant ce livre.
Une lecture comme un chemin vers nos propres anges, nos disparus, de nos trop tôt disparus.
Une errance sans but ni préméditation. Des fragments. Des questionnements. Et beaucoup d'amour.
Merci Monsieur Grumberg pour ce chaotique et doux voyage à la fois, pour cet intime partage.
Vous m'avez donné très envie de découvrir Tchekhov.« Comme moi tu devins très vite accro à Tchekhov, qui devint pour toi et moi celui qui nous fit découvrir notre propre humanité à travers celle des petites gens dont il peuplait ses nouvelles. Il nous montrait leur médiocrité, leur grandeur, leurs misères, leurs ridicules, tous ces amours gâchés, ces vies perdues et cependant vécues, dans la résignation certes, mais aussi dans la joie et l'espérance d'un monde meilleur, ce que nous vivions nous-mêmes. Ainsi, à travers Tchekhov et ses nouvelles nous espérions, malgré tout, sans trop y croire. »
« Incipit
Cette nuit
Tu es revenue cette nuit, chérie, sans prévenir. Je marchais dans une rue, harassé, hésitant, seul, vieux en somme, pourquoi ne pas le dire ? Vieux ? Quand je suis assis et que je parle, quand je dis des bêtises disons, pour peu que mon ou mes interlocuteurs se montrent assez complaisants pour rire de ces bêtises, je ne me sens pas vieux. Triste oui, mais vieux, non. Une fois seul, marchant, bousculé par les passants, évitant les trottinettes, les travaux, les vélos, les planches à roulettes, je me sens soudain si vieux, si seul...Enfin, cette nuit donc, dans cette rue inconnue, sans trottoirs, comme le sont les rues des vieilles villes de province, ou les rues piétonnes dans les villes italiennes, je marche et je sens comme une tape dans mon dos, légère, amicale, espiègle même. Je tourne la tête, bien sûr je ne vois personne. Mon œil droit ne voit jamais personne. Et comme je me tourne toujours du côté droit, je ne vois jamais personne. Je continue donc à marcher. Nouvelle tape, un tout petit peu plus forte. Cette fois je pivote sur la gauche, et là, mon œil valide te découvre ! Quelle joie ! Quel bonheur ! Tu es là devant moi. Je pourrais, si je le pouvais, si je le voulais même, te toucher. Tu souris, tu me souris, mutine, tendre, heureuse de m'avoir surpris. Pour toi, tout semble normal. Pour moi, c'est comme si je renaissais. »
« Peut-il y avoir soixante ans d'amour sans haine ? »
« Si j'écrivais non pas pour te ramener à moi - patati-patata pipeau et tralala -, mais bien plutôt pour tenter de réparer, l'une des dernières nuits de notre vie passée peu contre peau, unis dans notre lit matrimonial du siècle dernier. Oui, si c'était pour réparer ce que tu m'as demandé de réparer d'une voix amicale, aimante mais ferme, à savoir que selon toi, je n'aurais pas assez parlé de toi, de notre amour, disons, de l'importance de cet amour, dans ce que tu as eu la délicatesse de nommer « mon œuvre ». »
« Moi j'écris comme d'autres édifient des monuments pour honorer la mémoire de leurs disparus. Je tente ainsi d'ériger du bout de ma plume un palais de papier accessible à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de te connaître, donc de t'aimer. »
« J'en étais là quand Nadia, à l'âge de cinq mois, fut frappée par la mort subite des nourrissons. Dans la nuit qui suivit j'écrivis Chez Pierrot. Une pièce où ma douleur, ma rage, mon désespoir et mon dégoût s'exprimèrent sans retenue, comme malgré moi. Ce fut cette nuit-là que je découvris qu'on n'écrivait pas pour gagner sa vie, qu'on écrivait pour exprimer ce qu'on ne pouvait dire, qu'on écrivait pour crier sa douleur ou son amour, sa joie ou son désespoir, ou les deux. Et depuis je n'ai jamais pu revenir en arrière et écrire quoi que ce soit « pour gagner ma vie », ou la tienne. »
« « Ah je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions...»
Merde, je n'ai pas voulu au soir de ce 4 mai laisser le désespoir s'emparer de moi, et me voilà au bord des larmes, seul sur ce quai, alors que le train part et que j'agite mon mouchoir pour te dire au revoir. »
« On disait d'eux qu'ils s'étaient laissé conduire à l'abattoir comme des moutons, et nous, nous étions les agnelets de ces moutons-là. Il y eut même, au procès Papon, un témoin de « moralité », ancien ministre, ancien collègue donc de ce Papon, qui déclara qu'il ferait toujours une distinction entre ceux qui s'étaient laissé conduire à la mort sans résister et ceux morts les armes à la main. Honte à vous, ministres intègres, conseillers vertueux... »
« Il y a, dans Le Bréviaire de la haine de Léon Poliakov, paru en 1951 et que nous avons dû lire, toi et moi, dans les années 60, deux trois pages d'un témoignage. Ni d'une victime qui aurait miraculeusement échappé à l'assassinat, ni d'un bourreau, juste d'un témoin qui se trouvait là, par hasard, au bord d'une fosse, dans une sorte de terrain vague où on l'avait laissé inexplicablement pénétrer. Il relate en quelques mots la grandeur de ces gens. Des familles complètes, un village complet, attendent, nus, au bord d'une fosse. Ils attendent le moment d'être assassinés à leur tour, au bord de la fosse, alignés. C'est difficile. Certains risquent de tomber sur les morts pas encore tout à fait morts qui gisent à leurs pieds. Et sans cesse les parents, note le témoin, parlent à leurs enfants. Les jeunes aident et soutiennent les plus âgés. Ceux qui prient, prient. Un homme, vieux, barbe en bataille, désigne le ciel de son index comme s'il voulait indiquer aux autres leur destination prochaine. Nul n'implore, nul ne demande grâce, nul ne crie. Une jeune femme, nue, belle, se tape la poitrine entre ses deux seins en répétant « 24 », elle a vingt-quatre ans. L'âge peut-être de ce soldat qui fume, sa mitraillette posée sur ses genoux, assis en bord de fosse, jambes ballantes. Il jouit de sa pause règlementaire sans doute.
Qui est humain ? Qui est indigne de vivre ? Qui doit avoir honte, éternellement honte ? L'espèce humaine ?
Cette honte, je m'en suis peu à peu sorti, mais je n'ai pas été capable pendant mes soixante années d'écriture d'honorer, de célébrer, la mort et la dignité de ces gens. Est-ce ainsi qu'on doit mourir ? Sans crier grâce, sans pleurer, sans colère, sans rage, comme tu as su le faire, comme je ne savais pas que j'aurais à mon tout à le faire. »
« Trop de morceaux, trop de tout, et surtout trop de mots, trop d'adjectifs. Tu le sais, j'ai toujours voulu écrire comme Samuel Becket, à l'os, mais mon amour des adjectifs me fait en poser un, puis le considérant, solitaire, esseulé, je lui octroie un compagnon de jeu. Les deux adjectifs ensemble en appellent un troisième sans me consulter, et en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire ou le lire, je me trouve à la tête d'un quatuor d'adjectifs qui joue une musique inutile mais que je n'ose pas couper par amour de la musique. »
« Aujourd'hui, juste avant de poser mon stylo, arme fatale, sur le tas de cahiers noircis à l'encre noire de ma douleur, tempérée par le bleu et le rose de nos souvenirs heureux, je suis obligée de me poser cette question : à qui s'adresse un livre écrit pour toi que tu ne liras pas. »
« Te souviens-tu d'une de mes dernières critiques ? « Minces tranches de vie coupées très fines par un esprit très gros. » Ça nous avait fait beaucoup rire. Mais c'est la seule que nous connaissions tous deux par cœur et immanquablement elle te rappelait une note dans ton carnet à faire signer par tes parents : « Peut peu, fais moins. » »
Quatrième de couverture
C’est durant la réception internationale de La Plus Précieuse des marchandises que Jean-Claude Grumberg perd Jacqueline son épouse.
Depuis, jour et nuit, il tente de lui dire tout ce qu’il n’a pas pu ou pas osé lui dire. Sans se protéger, ni rejeter ce qu’il ne peut ni ne veut comprendre, il dialogue avec la disparue.
Incrédulité, révolte, colère se succèdent. Dans ses propos en cascades, réels ou imaginaires, qui évoquent la vie de tous les jours, Grumberg refuse de se raisonner, de brider son deuil. Les jeux de mots, l’humour, l’ironie, l’autodérision n’y changent rien.
Dans ce livre, où alternent trivialité et gravité, entre clichés et souvenirs, l’auteur dit la difficulté d’exprimer ce qu’il ressent.
Jean-Claude Grumberg fait son livre « pour et avec » Jacqueline, exaltant l’amour et l’intimité de la vie d’un couple uni pendant soixante ans.
Éditions Seuil, août 2021
282 pages
Prix littéraire le monde 2021