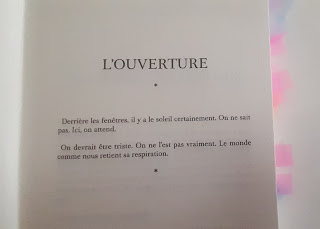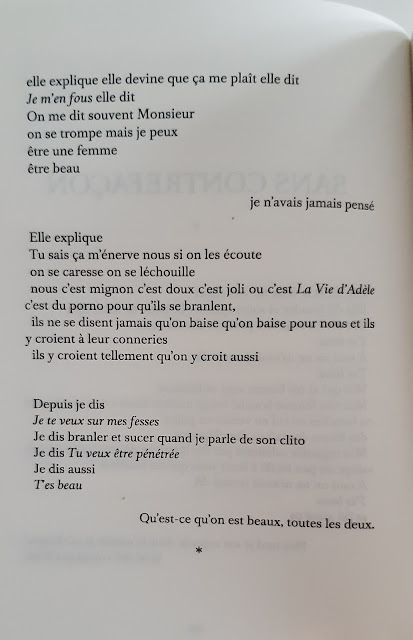Le papa de la narratrice a cherché toute sa vie le vide, le silence pour fuir son "Là-bas" prégnant et lourd à porter. Tellement lourd que sa fille semble être passée dans sa vie comme une ombre.
Des années de mutisme.
Des traumatismes.
Des non-dits.
Une famille écartelée.
Par ces non-dits justement.
Elle est troublante cette littérature qui résonne autant en son lecteur.
Une auteure qui livre sa douleur, sa colère.
Et moi, troublée, émue, touchée, émerveillée par de nombreux passages.
J'aime beaucoup la plume de cette auteure qui évoque toujours avec tant grâce nos fragilités.
À lire , ou pas, c'est vous qui voyez ;-)
« Un jour, j'ai lu une histoire qui m'a fait trembler. Turin, le 3 janvier 1889, piazza Alberto. Le jour où Nietzsche s'est jeté à la tête d'un cheval de fiacre épuisé, frappé jusqu'au sang par son cocher, jusqu'à s'écrouler au sol, jambes brisées. Nietzsche a enlacé le cheval comme un frère humain, il l'a embrassé dans un geste de consolation impossible, désespéré. Ensuite, il s'est écroulé, a perdu conscience. La grande absence. Tout a lâché, le corps et l'âme, la maladie mentale ne l'a plus quitté, jusqu'à la fin, dix ans plus tard. Humain, trop humain, je crois que j'ai compris là ce que ça pouvait vouloir dire. »
« Et parce que la parole ne peut aller beaucoup plus loin, j'écris ce silence qui ira seul ouvrir le chemin. »
Pierre CENDORS, Minuit en mon silence.
En exergue
« Tes mots terribles, qui blessent, entaillent, écorchent, tailladent au sang, au cœur, à l'âme. Mais quelle famille? Je n'ai pas de famille ! Tu as dit ça, oui, tu as dit ça, un jour où j'étais venue. J'avais commis l'erreur de prononcer ce gros mot, ce mot de famille, pour je ne sais plus quelle raison, me rassurer, peut-être, faire sonner ces deux syllabes comme pour en faire surgir une réalité qui m'échap pait, comme on bat deux silex pour en faire jaillir une étincelle, prémices d'un feu. Et toi tu nous reniais, tout simplement. C'est bien toi, ça. Lancer tes explosifs aux moments les plus inattendus et te désintéresser des dégâts. On a beau savoir, on ne s'y fait pas. »
« Et maintenant, mon père, mon père terrible, te voilà qui entres dans la brume, à petits pas et sans retour. Tu arrives au temps des sables mouvants. Te voilà à l'orée de l'oubli, de tous les oublis, te voilà au seuil de la pénombre, je suis ta fille absente, ta fille invisible et pourtant je tremble à l'idée qu'un jour tu ne connaîtras plus ni mon nom ni mon visage. Aurai-je traversé toute ta vie comme une ombre ? »
« La mémoire des lieux. Je n'y peux rien, je porte ça en moi depuis toujours. J'ai la mémoire monstrueuse, oui, monstrueuse, hémorragique, débordante. Parfois, un visage s'efface ou un nom s'évapore. Un lieu, jamais. »
« On ne sait jamais quoi faire du chagrin des autres. Et toi, mon père, qu'as-tu fait du nôtre? Y a-t-il un lieu en toi pour le perdre, pour l'égarer, pour l'oublier, un lieu où tu ne vas jamais ? »
« C'est une photo d'Amarcord, de Fellini, l'apparition du Rex, le paquebot triomphal, éclairé comme pour une fête somptueuse, dans la nuit, un peu flou, beau comme un songe, avec les hommes, les femmes qui s'en approchent dans des barques et le saluent à grands gestes, comme une divinité qui nous ferait l'aumône d'un bref passage sur terre. Et l'apparition s'évanouit. Plus tard, j'ai regardé mille fois cette scène, elle m'étreint, je ne sais pas dire pourquoi. Ce rêve qui passe, proche et lointain, cette ferveur, suivie de cette disparition. Le surgissement de quelque chose qui nous porte. Plus loin, plus haut. Comme ta montagne, père. »
« J'ai ajouté les miennes et je me suis tenue debout. Sans mots et sans pensées, là, simplement, près de toi, maman. Toi qui as passé ta vie à détourner la colère du père, maman paratonnerre, un arbre qui absorberait la foudre en souriant, consumé mais debout. Je suis partie lorsque j'ai entendu grincer la grille. Je ne voulais pas croiser d'autres vivants que toi, maman, dans mon cœur. »
« Je ne comprenais pas le monde. J'avais peur de la nuit à la maison, je haïssais la montagne qui m'empêchait de voir la vie au loin. Là, dans ce musée, on enfermait des créatures vivantes pour se repaître de leur beauté. Pourtant, c'est grâce à cela que j'ai découvert ma voie, même si ce mot peut sembler présomptueux. Ce paradoxe me perturbait. Plus tard, j'ai haï le cirque, tous les dressages, les spectacles, les exhibitions d'animaux sous des prétextes divers, c'était quelque chose de viscéral, d'irraisonné. Laissez-les tranquilles. »
« Un jour, j'ai lu une histoire qui m'a fait trembler. Turin, le 3 janvier 1889, piazza Alberto. Le jour où Nietzsche s'est jeté à la tête d'un cheval de fiacre épuisé, frappé jusqu'au sang par son cocher, jusqu'à s'écrouler au sol, jambes brisées. Nietzsche a enlacé le cheval comme un frère humain, il l'a embrassé dans un geste de consolation impossible, désespéré. Ensuite, il s'est écroulé, a perdu conscience. La grande absence. Tout a lâché, le corps et l'âme, la maladie mentale ne l'a plus quitté, jusqu'à la fin, dix ans plus tard. Humain, trop humain, je crois que j'ai compris là ce que ça pouvait vouloir dire. J'ai eu envie de faire un film, un court-métrage avec cette histoire, et c'est resté une envie. Je crois que quelqu'un d'autre l'a fait. Je n'ai pas regardé, mes images sont dans ma tête, je ne suis pas capable de les partager. Cette scène m'obsède. Je me suis revue à douze ans, en larmes, près des requins. »
« Ton père a une épine dans le coeur, Isabelle, ça l'empêche de vivre et ça le rend invivable, c'est tout. Il y a eu de la bonté en lui, j'en suis certain. Un jour tu feras la paix. Voilà ce que Vincent m'avait dit un jour sur toi. Il ne parvient pas à traverser sa propre nuit, avait-il ajouté. [...] On sait rien des autres, accepte-le ; Je n'ai jamais pu lui parler du cri. Le renard enragé continuait de me dévorer le ventre. »
« Et toi, mon père qui avance à pas lents vers les ombres qui vont t'ensevelir vivant, où en es-tu? Je m'aperçois que je ne te connais pas. Je me sens perdue moi aussi. Chacun dans sa pénombre. La tienne me fait une peine infinie. Je ne m'attendais pas à éprouver cela. Que puis-je faire pour te retenir parmi nous ? »
« Maman, Hélène. D'où venait ton inlassable patience, ton inlassable attention pour cet homme qui te regardait si peu ? II m'a fallu du temps, il a fallu Vincent pour que je comprenne que tu l'aimais, et rien d'autre. »
« Les petits papiers dans tes poches. Nos noms. Ta dignité. Le Petit Poucet contre l'ogre de l'oubli. Alors, ce n'était pas toi, l'ogre, mon père ? »
« Apprendre à devenir un soldat. Un guerrier. Subir les corvées et les brimades sans broncher. Reconnaître les galons des gradés, saluer, courir au pas de gymnastique, toujours et sans raison, se mettre au garde-à-vous, tirer, démonter et remonter un fusil d'assaut, courir avec un paquetage, obéir, quel que soit l'ordre et quoi qu'on en pense, bien secouer ses chaussures le matin avant de les enfiler. Les scorpions. Le médecin du camp nous avait mis en garde, dans son discours d'accueil, les dangers du soleil, des bestioles, de l'eau, des femmes et des maladies vénériennes, photos à l'appui, de quoi se calmer un moment. »
« La pacification, c'était un mot pour les politiques, pour ne pas effrayer les citoyens, les électeurs, les parents à qui on voulait faire croire que les voyages forment la jeunesse. Continuer à leur faire croire que ce beau pays était et resterait la France pour l'éternité, comme la Provence ou la Normandie. Mais c'était la guerre, et quand je regardais autour de moi, notre groupe, tablée, le dortoir, je me disais que certains ne rentreraient pas vivants, et que j'étais peut-être l'un d'eux. »
« Un nom. Un lieu. Palestro. Une date, le 18 mai 1956. Dix-neuf morts, deux disparus. Des atro cités, des corps de soldats torturés, éviscérés, mutilés, des visages figés dans la souffrance, des yeux ouverts sur l'horreur, des bouches tordues, langues arrachées, pétrifiées dans des cris muets, des images qui vous empêchent de dormir pendant un paquet de nuits. L'ennemi prenait corps, on comprenait qu'on était venus faire la guerre et qu'on pouvait y rester. Oui, c'était la guerre, pas les événements. On nous disait que tout cela serait bientôt fini. L'Algérie, la belle Algérie aux villes blanches et aux immenses domaines agricoles tenus d'une main de fer par les colons, resterait française, et l'on rentrerait chez nous, fier d'avoir pris part à l'écriture de cette page de l'Histoire. On allait aider à la pacification. On nous disait que c'était ça, notre mission. »
« En arrivant, je suis allé me laver, j'étais dans un état pitoyable. J'ai demandé à voir le capitaine, j'ai raconté. Enfer promis ou pas, je ne pouvais faire autrement. J'ai demandé à faire un rapport écrit. Ecoutez, Erard, foutez-nous la paix avec ça. C'est la guerre, ce n'est pas une cour de récréation, ici, il faut vous y faire. Tous les jours, des nôtres y laissent la peau. Dites-moi, de quel côté êtes-vous ? Allez, rompez.
Le soir même, nous avons perdu trois hommes dans une embuscade. Les corps déchiquetés par une mine, un magma de sable, de sang, de tissus. J'ai pris mon tour de garde au milieu de la nuit, grelottant de peur, de honte, de fièvre. Puceau de l'horreur. J'ai compris ce que ça voulait dire. »
« J'étais un fantôme en rentrant ici après vingt-huit mois de vie volée. Plus de deux ans. On parlait encore des événements, un drôle de mot pour dire l'horreur des deux côtés, pour dire un peuple que ne peut arrêter lorsqu'il a décidé de reprendre sa liberté.
À la radio, on entendait du rock, du twist, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, on allait au cinéma voir Brigitte Bardot, Alain Delon. Je n'appartenais plus à ce monde-là. J'ai tenté de reprendre le cours de mes études. Un naufrage. J'étais un étudiant trop âgé, j'avais vécu des choses qui ne peuvent se raconter et que personne ne voulait entendre ni ne pouvait même soupçonner. Je ne pouvais plus écouter les professeurs en costume étriqué pérorer sur leur estrade, ça n'avait plus de sens de s'inquiéter pour un examen ou de s'exciter sur une soirée étudiante dans un café. »
« Vendredi 1" janvier 2021
Je suis le fils, celui qui n'est jamais parti.
Celui qui est resté vivre dans l'ombre de la montagne.
Celui qui parle maintenant, au seuil franchi d'un an nouveau.
Celui qui vient d'enterrer un père.
Celui demeuré près d'un homme sur le point de chuter, près d'un silence que j'ai fini par accepter. À la mort de maman, j'ai compris qu'il allait tomber, dévoré par ses monstres, et qu'il fallait quelqu'un pour les tenir encore un peu à distance. J'ai accepté d'en être le pauvre dompteur sans cravache ni costume de cirque. J'ai accepté d'être là, et rien d'autre. Ça n'a pas été un sacrifice héroïque et vertus, je ne suis pas un héros, et j'ai toujours aimé, contrairement à Isabelle, vivre ici
J'aime ces racines puissantes et paisibles, j'aime vivre près des arbres, des torrents, des rochers, dans un paysage que je redécouvre chaque jour, sculpté par les saisons, par les nuages, par le vent et la lumière, Isabelle, mon Isabelle, la flamboyante, ma soeur, ma soeur sauvage, ma sœur rétive, a toujours eu le départ dans la peau. L'impatience des ail leurs, dès l'enfance je crois. Elle a la curiosité des mondes de l'océan et le talent de les montrer dans leur splendeur et leur fragilité.
Je me contente de soulager, comme je le peux, les corps souffrants qui viennent à moi, d'être celui qui est disponible pour les écouter. Cela me comble. Que mes mains soient des instruments qui apaisent. Je n'en ai guère demandé plus à la vie. Pour le reste, rien de très glorieux. Des jours mats, qui se suivent. Et une vraie grande blessure qui se ravive avec bien trop de facilité. Je n'ai pas su garder la femme que J'ai aimée, j'ai manqué pour elle de l'attention et de la patience que j'ai réservées à d'autres.
Un jour, elle s'est lassée. J'ai retrouvé un soir ses clés sur la table et les armoires vidées. Je n'imaginais pas que l'on puisse finir ainsi une histoire de plusieurs années. On peut. Parfois, je me demande si ce n'est pas cette manière de partir qui m'a blessé plus encore que le départ. L'abandon, le silence, l'orgueil peut-être aussi, mais la peine, la vraie peine, celle qui vous cloue le cœur et les mâchoires, celle qui ferme l'horizon et qui alourdit les pas. À croire que je ne méritais même pas un mot dit en face et qu'il n'y avait rien à tenter, rien à sauver. Peut-être. J'avais laissé glisser notre histoire sans en prendre soin, il n'y avait sûrement rien d'autre à en dire. Quand je me regarde en face, je reconnais que je me suis souvent montré coléreux, ombrageux sans raison, prompt à m'emporter. Le sang du père. Il est en moi, je le tiens à distance, mais parfois il me déborde. Je ne me supporte pas ainsi, avec cette espèce de malédiction sous la peau, capable de bondir sans avertissement. Silvia n'en a plus voulu, j'ai éteint la gaieté en elle. Et ce n'est même pas pour un autre qu'elle est partie. »
« J'ai aimé, et puis le temps a effiloché une histoire qui n'était pas armée pour faire face. Il faut beau coup d'amour pour résister à toutes les érosions, je n'en ai pas donné assez, c'est tout. Isabelle aussi a aimé, et cet amour lui a été repris. À l'heure où les ombres s'allongent, nous avançons tous les deux comme nous pouvons. »
« Il y a des lieux qu'il faut laisser à l'espace, au silence. »
« Le jour où nous avons porté notre père en terre, peu avant Noël, c'était une matinée claire, froide, comme il les aimait, la montagne éternelle et obstinée veillait au-dessus de nos têtes, et pour la dernière fois, pour cet ultime accompagnement, nous avons encore été ses enfants. Au cimetière, sous le ciel vif, Isabelle a lu un poème, Chacun de sa larme secrète, arrose une fleur connue de lui seul. Moi, j'ai choisi de faire entendre la dernière prière de Johnny Cash, Help Me, des paroles qui me retournent à chaque fois, c'est ce que je pouvais lui offrir de mieux. C'est Isabelle qui m'a porté tout au long de ce jour-là. »
Quatrième de couverture